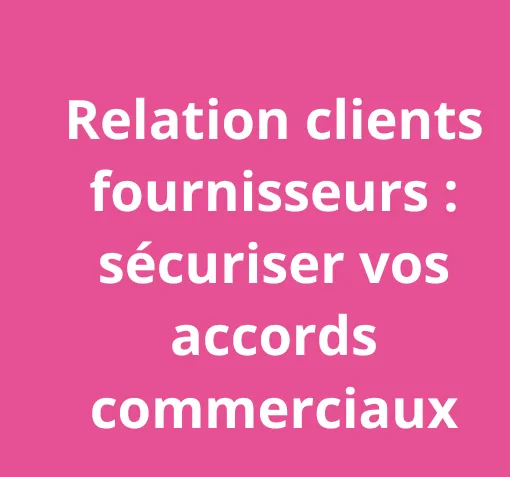
Relations clients-fournisseurs : comment sécuriser vos accords commerciaux
La structuration et la gestion des relations avec les fournisseurs sont une pierre angulaire de la performance et de la pérennité des réseaux de commerce organisé, notamment en franchise. Pour la tête de réseau, qui orchestre ces relations, la maîtrise des cadres juridiques applicables est essentielle pour sécuriser ses intérêts, optimiser son modèle économique et prévenir les contentieux. Que la tête de réseau agisse comme une centrale d’achat, achetant pour revendre aux membres du réseau, ou comme une centrale de référencement, négociant des conditions pour le compte de ces derniers, les points de vigilance sont nombreux et stratégiques.
Cet article se propose d’analyser les mécanismes de sécurisation des accords commerciaux dans le cadre d’une relation clients fournisseurs, en s’appuyant sur les distinctions fondamentales entre les différents modèles d’approvisionnement et en détaillant les obligations légales et les risques qui y sont associés.
Le choix du modèle d’approvisionnement : une décision structurante
La première étape pour sécuriser les relations et contrats avec ses fournisseurs consiste à définir clairement le rôle de la tête de réseau. Deux modèles principaux se distinguent, avec des conséquences juridiques radicalement différentes
Le modèle de la centrale d’achat : la maîtrise par l’interposition
Dans cette configuration, la tête de réseau (ou une filiale dédiée) achète les produits en son nom propre auprès des fournisseurs pour les revendre ensuite aux membres de son réseau. Juridiquement, ce modèle repose sur deux contrats de vente successifs et distincts.
L’avantage principal pour la tête de réseau est la clarté et la sécurité de la relation. En tant qu’acheteur-revendeur, elle est le seul interlocuteur de ses fournisseurs. Les conditions négociées en amont, notamment les remises, ristournes et autres avantages financiers, lui sont acquises en propre. Par conséquent, elle n’a aucune obligation de transparence ou de reddition de comptes envers les franchisés sur les marges qu’elle réalise.
Ce modèle permet à la tête de réseau de conserver la totalité des avantages négociés avec les fournisseurs, qui constituent une source de revenus directe et confidentielle. La relation avec les franchisés est celle d’un vendeur à un acheteur, régie par les conditions générales de vente de la centrale.
Le modèle de la centrale de référencement : une complexité juridique à maîtriser
Plus souple opérationnellement, le modèle de la centrale de référencement consiste pour la tête de réseau à sélectionner des fournisseurs et à négocier des conditions commerciales-cadres, en vertu desquelles les franchisés passeront directement leurs commandes. La tête de réseau n’achète ni ne revend la marchandise.
Cette structure, si elle allège la logistique et les risques de stock, génère une complexité juridique accrue, notamment concernant le statut de la tête de réseau et le sort des avantages financiers (ristournes, budgets de coopération commerciale) versés par les fournisseurs
La gestion des avantages financiers : la qualification du rôle de la tête de réseau
Lorsque la tête de réseau agit en tant que centrale de référencement, la question de la propriété des sommes versées par les fournisseurs est une source majeure de contentieux. La réponse dépend de la qualification de son intervention, qui doit être précisément définie dans le contrat de franchise ou un accord-cadre de référencement.
L’hypothèse du mandat ou de la commission : transparence et restitution de principe
Si le contrat stipule que la tête de réseau agit « au nom et pour le compte » des franchisés, elle est qualifiée de mandataire (C. civ., art. 1984). Si elle agit « pour le compte » des franchisés mais en son nom propre, elle est un commissionnaire (C. com., art. L. 132-1)
Dans ces deux cas, la tête de réseau est soumise à une obligation de rendre compte de sa gestion, conformément à l’article 1993 du Code civil. Combinée à la gratuité de principe du mandat, cela implique qu’elle doit, en principe, restituer aux franchisés l’intégralité des sommes perçues des fournisseurs en leur nom et pour leur compte.
Pour que la tête de réseau puisse conserver une partie de ces sommes, le contrat de franchise doit le prévoir explicitement, par exemple en stipulant que cette conservation constitue la rémunération par le franchisé des services de négociation et de référencement du franchiseur.
L’hypothèse du courtage : une flexibilité contractuelle accrue
La tête de réseau peut également être qualifiée de courtier. Dans ce rôle, elle se contente de mettre en relation les fournisseurs et les franchisés pour qu’ils contractent ensemble. Le courtier n’est pas un représentant et n’a, par défaut, aucune obligation de reddition de comptes.
Ce modèle offre une plus grande flexibilité. La tête de réseau peut négocier avec les fournisseurs qu’une partie des avantages financiers lui soit directement versée, non pas en tant que mandataire des franchisés, mais en rémunération par le fournisseur de son service de référencement auprès de son réseau.
Pour ce qui est de la négociation des conditions applicables par le fournisseur aux franchisés cela peut être organisé via une stipulation pour autrui, où le fournisseur s’engage envers le franchiseur à appliquer certaines conditions contractuelles aux franchisés.
Cependant, cette liberté n’est pas sans risque. Les juges peuvent requalifier un contrat de courtage en mandat si, dans les faits, la tête de réseau s’immisce de manière trop importante dans la conclusion ou l’exécution des contrats entre fournisseurs et franchisés. De plus, la transparence est requise. Le principe d’une rémunération versée au courtier doit être porté à la connaissance des franchisés en exécution de l’article L.131-11 du code de commerce : une clause claire dans le contrat de franchise, informant les franchisés que la tête de réseau à un intérêt dans l’opération du fait de la perception d’une rémunération des fournisseurs référencés, est indispensable.
Attention, si l’accord prévoit, outre la rémunération du franchiseur pour sa mise en relation, des remises ou ristournes pour les franchisés en fonction de leurs volumes d’achats individuels, ces sommes devront en toute hypothèse leur être reversées, même si le paiement en est centralisé par le fournisseur auprès du franchisé. Il est essentiel dans les accords avec les fournisseurs de bien catégoriser et qualifier les diverses sommes dont le paiement est prévu pour bien identifier leur régime juridique propre.
La Négociation et l’Exécution des Accords Commerciaux : Maîtriser les Risques des « Services de Coopération Commerciale »
Les centrales de référencement facturent fréquemment aux fournisseurs des « services de coopération commerciale ». Ces services, destinés à favoriser la commercialisation de leurs produits (mise en avant promotionnelle, transmission d’informations, etc.), doivent être formalisés dans la convention unique annuelle (ou pluriannuelle) prévue à l’article L. 441-3 du Code de commerce
La jurisprudence est constante et sévère à l’égard des services jugés fictifs, non-distincts de la fonction naturelle de distributeur, ou rémunérés de manière disproportionnée.
- La réalité et la spécificité du service : Le service facturé doit être réel, effectif et précisément défini. Il doit être « détachable de l’achat-vente », ou du seul référencement, c’est-à-dire aller au-delà de ce qu’un distributeur ou un référenceur ferait naturellement dans le cadre de son activité.
- La proportionnalité de la rémunération : Même si un service est réel, sa rémunération ne doit pas être « manifestement disproportionnée » par rapport à sa valeur. L’appréciation se fait au cas par cas, mais une rémunération exorbitante pour une prestation mineure sera sanctionnée.
D’autres pratiques sont également prohibées et doivent faire l’objet d’une attention particulière :
- Les avantages rétroactifs : Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant le bénéfice rétroactif d’accords de coopération commerciale (C. com., art. L. 442-3)
- Le « droit d’entrée » : Le fait d’exiger un paiement comme condition préalable au référencement, sans engagement écrit sur un volume d’achat proportionné, est une pratique illicite
Recommandation pratique : La tête de réseau doit mettre en place une discipline stricte dans la contractualisation et le suivi des services de coopération commerciale. Chaque service doit être décrit avec précision dans la convention unique, sa réalisation doit être prouvée (photos, rapports, etc.), et sa valorisation doit être justifiable.
La sécurisation de la relation dans la durée : anticiper les risques de rupture et d’imprévision
Au-delà de la structuration initiale, la sécurisation des accords commerciaux s’inscrit dans la durée et implique d’anticiper les aléas de la vie des affaires.
Le risque de rupture brutale des relations commerciales établies
Lorsqu’une tête de réseau décide de mettre fin à sa relation avec un fournisseur référencé (déréférencement), elle s’expose au risque d’une action fondée sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie (art. L. 442-1, II du Code de commerce). Ce risque est particulièrement élevé lorsque la relation est ancienne, stable et que le fournisseur réalise une part significative de son chiffre d’affaires avec le réseau.
Pour se prémunir, la tête de réseau doit notifier sa décision en respectant un préavis écrit d’une durée suffisante, qui tienne compte, notamment de la durée de la relation commerciale mais également d’autres circonstances : l’existence d’une dépendance économique de la victime de la rupture, l’importance du volume d’affaires, l’existence d’investissements spécifiques non amortis ou encore l’existence d’une éventuelle exclusivité. La loi prévoit une durée maximale de 18 mois. Il est donc crucial de documenter la décision de déréférencement, de la fonder sur des motifs objectifs (performance, évolution de la stratégie du réseau, etc.) et de gérer la transition de manière professionnelle pour minimiser le préjudice du fournisseur.
La gestion des bouleversements économiques et l’imprévision
Les contrats de réseau, conclus pour une longue durée, sont exposés aux bouleversements économiques (crises, flambée des coûts des matières premières, etc.).
Tout d’abord, l’article L.441-3 du code de commerce relatif à la convention unique prévoit qu’en cas de convention unique pluriannuelle, elle doit fixer « les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production ».
Il est en outre imposé que les contrats portant sur les « produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse » (art. L. 441-8 Ccom).
Pour tous les contrats, depuis la réforme du droit des contrats de 2016, l’article 1195 du Code civil a introduit la théorie de l’imprévision dans le droit commun. Ce mécanisme permet à une partie de demander la renégociation du contrat lorsque son exécution est devenue excessivement onéreuse en raison d’un changement de circonstances imprévisible.
Pour une tête de réseau, ce texte représente un risque d’instabilité contractuelle. Il est donc courant et recommandé d’insérer dans les contrats de franchise et les accords de référencement une clause qui écarte l’application de l’article 1195, faisant ainsi supporter le risque de l’imprévision à chaque partie. Ce qui n’empêche évidemment pas les parties de renégocier si elles le souhaitent, mais évite en cas de désaccord de soumettre le contrat à l’appréciation souveraine du juge, qui pourra décider d’en modifier les conditions voire de le résilier.
Toutefois, la validité d’une telle clause d’exclusion doit être appréciée au regard du droit des pratiques restrictives de concurrence. Si elle n’a pas été librement négociée et qu’elle crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (art. L. 442-1, I, 2° du Code de commerce), elle pourrait être remise en cause
De plus, il convient de noter que l’article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance de 2019, permet de sanctionner l’obtention d’un avantage manifestement disproportionné « dans le cadre de […] l’exécution d’un contrat ». Ce texte pourrait être interprété comme une porte d’entrée à une forme de révision judiciaire du prix en cours de contrat, contournant ainsi les clauses d’exclusion de l’imprévision
En conclusion, la sécurisation des relations fournisseurs pour une tête de réseau ne se résume pas à la simple négociation de tarifs. Elle exige une architecture juridique rigoureuse et anticipatrice. Le choix entre un modèle de centrale d’achat et de centrale de référencement est la première décision stratégique. Dans le second cas, une rédaction contractuelle précise sur la qualification du rôle de la tête de réseau (mandat, courtage) et sur le sort des avantages financiers est impérative pour prévenir les contentieux. Enfin, la gestion dynamique du contrat, incluant l’anticipation des risques de rupture et la neutralisation contractuelle de l’imprévision, est la clé pour protéger les intérêts de la tête de réseau et assurer la stabilité de l’ensemble du réseau de distribution. Il ne faut pas hésiter dans ce cadre à solliciter des conseils juridiques adaptés à la situation de son entreprise.
Découvrez nos services et outils associés

Relations clients fournisseurs
Stratégie juridique de regroupement à l'achat
Centrale d’achat ou de référencement ?
Faut-il privilégier un modèle où vous achetez et revendez à vos adhérents (centrale d’achat) ou un modèle où vous négociez des conditions de vente auprès de fournisseurs qui vendront directement à vos adhérents (centrale de référencement) ?
Quels sont les impacts de ces choix en termes de modèle économique, d’organisation, de responsabilité ?
En cas de référencement, quelle qualification juridique du rôle de la centrale et qu’est-ce que cela implique pour elle ?
Comment accroître et sécuriser les revenus de la centrale ?
Centrale d’achat ou de référencement ?
Faut-il privilégier un modèle où vous achetez et revendez à vos adhérents (centrale d’achat) ou un modèle où vous négociez des conditions de vente auprès de fournisseurs qui vendront directement à vos adhérents (centrale de référencement) ?
Quels sont les impacts de ces choix en termes de modèle économique, d’organisation, de responsabilité ?
En cas de référencement, quelle qualification juridique du rôle de la centrale et qu’est-ce que cela implique pour elle ?
Comment accroître et sécuriser les revenus de la centrale ?

Relations clients fournisseurs
Rédaction des contrats d'affiliation à la centrale d'achat ou de référencement
Vous avez choisi votre stratégie d’organisation de centralisation des approvisionnements.
Les contrats d’affiliation à la centrale conformément au choix de la qualification juridique du rôle de la centrale (qui détermine son financement, sa responsabilité, et donc ses risques, mais aussi son modèle économique) sont à rédiger de manière personnalisée pour assurer la performance de votre modèle.
Vous avez choisi votre stratégie d’organisation de centralisation des approvisionnements.
Les contrats d’affiliation à la centrale conformément au choix de la qualification juridique du rôle de la centrale (qui détermine son financement, sa responsabilité, et donc ses risques, mais aussi son modèle économique) sont à rédiger de manière personnalisée pour assurer la performance de votre modèle.

Relations clients fournisseurs
Rédiger les contrats de référencement fournisseurs et conventions uniques
Le résultat de la négociation avec les fournisseurs est formalisé dans un accord cadre.
Vous doter d’un accord de référencement, de manière à encadrer et à standardiser vos modes de relations avec vos fournisseurs est essentiel.
Le résultat de la négociation avec les fournisseurs est formalisé dans un accord cadre.
Vous doter d’un accord de référencement, de manière à encadrer et à standardiser vos modes de relations avec vos fournisseurs est essentiel.
Et les ressources sur le même thème : "Mise en place de centrales d'achat ou de référencement"
Relations clients fournisseurs
Courtage ou mandat : De l’importance de bien qualifier le contrat
Sous peine d’être soumis à des obligations non souhaitées. La qualification juridique d’une opération est essentielle pour en déterminer le régime applicable. A cet égard, la rédaction des contrats est essentielle pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur la qualification à retenir. Une décisi…
Relations clients fournisseurs
Centrale de référencement et centrale d’achat
La massification des achats constitue un avantage considérable pour les distributeurs de vos réseaux, permettant d’obtenir des prix d’achats avantageux, pour gagner en part de marché ou conforter vos marges commerciales. Deux types de cas existent : Le regroupement à l’achat, souvent organis…
Réseaux de distribution, Concurrence
Action du Ministre et compétence du Tribunal de commerce de Paris
En application des dispositions internes du Code de procédure civile, le Tribunal de commerce de Paris est territorialement compétent pour connaître de l’action du Ministre à l’encontre de sociétés de droit belge. La Cour d’appel de Paris (21 février 2024, n°21/09001) a confirmé la compéte…
Réseaux de distribution, Concurrence
Nouveaux règlements d'exemption de la Commission sur les accords horizontaux
Le 1er juin 2023, la Commission européenne a adopté une version révisée des règlements d’exemption par catégorie applicables aux accords horizontaux en ce qui concerne les accords de recherche et développement et les accords de spécialisation. L’article 101, paragraphe 1, du TFU…




