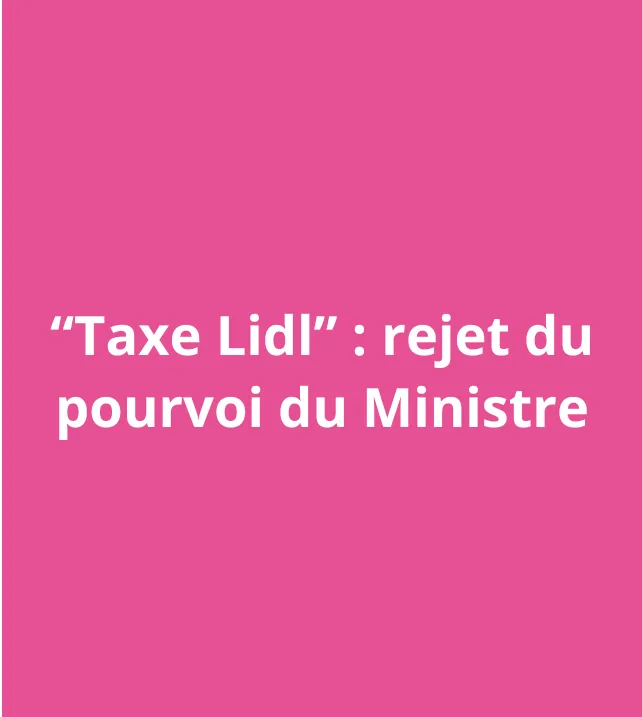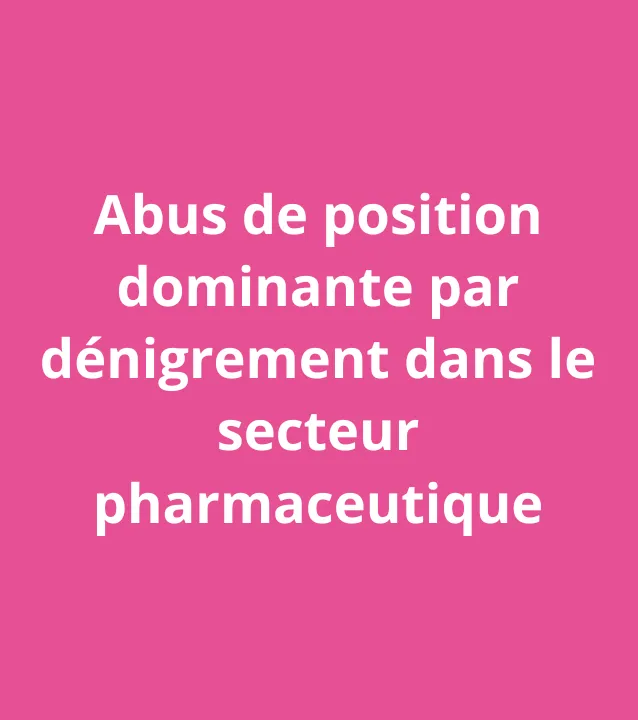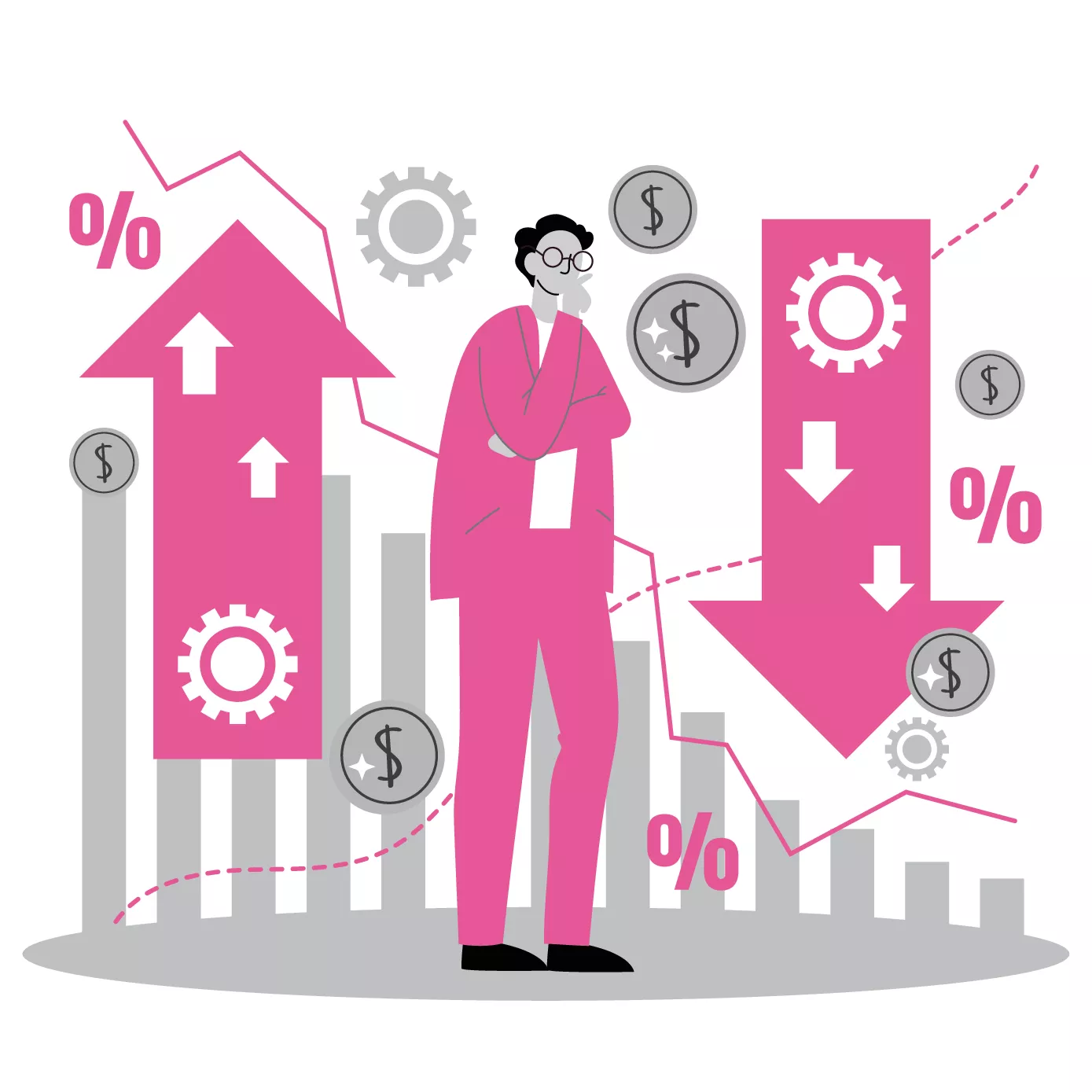Abus de position dominante et opérateur historique : sanction de l’information tardive et incomplète dans le cadre d’appels d’offres
Le 30 mai 2018, la Cour de cassation a rendu son arrêt dans l’affaire des pratiques mises en œuvre par TDF dans le secteur de la diffusion de la télévision par voie hertzienne terrestre en outre-mer.
A l’occasion d’un arrêt rendu le 30 mai 2018, la Cour de cassation a rejeté dans son intégralité le pourvoi formé par TDF contre l’arrêt de Cour d’appel de Paris qui était venue confirmer pour l’essentiel la décision de l’Autorité de la concurrence par laquelle elle avait sanctionné TDF à hauteur de 4,2 millions d’euros pour avoir abusé de sa position dominante.
Les faits :
En 2010, France télévisions a lancé 9 appels à candidatures en vue de l’attribution des marchés de la diffusion de la TNT dans les territoires et collectivités d’outre-mer (contrats de cinq ans).
Trois opérateurs ont répondu à ces appels à candidatures en vue de déposer des offres, dont TDF, opérateur historique en diffusion hertzienne terrestre et OMT, premier opérateur alternatif de télécommunications en outre-mer.
Avant et pendant le déroulement du dialogue compétitif prévu par le règlement des appels d’offres, TDF n’a publié aucune des informations techniques et tarifaires relatives à l’accès à ses infrastructures, qui étaient pourtant nécessaires à ses concurrents pour répondre aux appels d’offres.
Cette absence d’offre de référence pour l’hébergement sur les pylônes indispensables à la diffusion de la TNT a notamment conduit OMT à renoncer à formuler des offres pour les territoires où elle était candidate et les neuf marchés ont été attribués à TDF.
Décision n°15-D-01 de l’Autorité de la concurrence du 5 février 2015 :
L’Autorité a considéré que TDF avait abusé de sa position dominante en empêchant ses concurrents de participer aux appels d’offres lancés par France Télévisions pour le déploiement de la TNT en outre-mer dans des conditions normales de concurrence, sans subir une asymétrie d’information.
À cet égard, l’Autorité avait pris soin de préciser qu’elle ne sanctionnait pas un manquement à l’obligation, imposée par l’ARCEP, de publier une offre de référence, mais une pratique autonome sur le marché qui a consisté à utiliser la position dominante détenue sur le marché de gros amont de l’hébergement pour « retarder sans motif fondé la publication de l’offre de référence Hébergement pour les régions d’outre-mer, en omettant d’y faire figurer certains éléments déterminants ».
L’Autorité de la concurrence avait donc sanctionné TDF à hauteur de 4,2 millions d’euros.
Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30 septembre 2016 :
TDF a fait appel de la décision rendue par l’Autorité.
La Cour d’appel de Paris a censuré la décision de l’Autorité seulement sur la question de sa compétence pour connaître des pratiques mises en œuvre à Wallis et Futuna.
Les juges du fond ont considéré que si l’Autorité était bien compétente pour appliquer le droit national de la concurrence à Wallis et Futuna au moment des faits litigieux, en revanche elle ne l’était pas pour appliquer les règles européennes de concurrence, le TFUE s’appliquant aux territoires ultramarins à l’exception des « pays et territoires d’outre-mer » (ou «PTOM »), dont Wallis et Futuna fait partie.
La Cour d’appel a donc annulé la décision de l’Autorité en ce qu’elle a examiné les pratiques commises à Wallis et Futuna sous le double fondement des articles L.420-2 du code de commerce et 102 TFUE.
Toutefois, souligne la Cour, cette modification est sans effet sur la qualification des pratiques et les sanctions à prononcer, et confirme dans leur intégralité les constatations de l’Autorité de la concurrence.
Arrêt de la Cour de cassation :
Dans son pourvoi, TDF contestait plusieurs sujets :
1 – Délimitation géographique des marchés pertinents
TDF soutenait qu’il convenait de retenir l’existence d’un marché géographique distinct pour chaque territoire ultramarin.
Sur ce point, la Chambre commerciale de la Cour de cassation approuve le choix validé par la Cour de Paris de séparer le marché ultramarin, constitué de l’ensemble des territoires ultramarins, du marché métropolitain. Elle estime d’une part que la preuve a été apportée de ce que les conditions de concurrence étaient homogènes au sein du marché ultramarin et, d’autre part, que TDF n’a pas démontré en quoi les conditions de concurrence différeraient entre chacun de ces territoires.
2 – Sur le caractère non-réplicable dans des conditions économiquement raisonnables des infrastructures de TDF.
TDF soutenait encore que la Cour d’appel n’avait pas démontré en quoi les infrastructures qu’elle détenait pouvaient être considérées comme non réplicable dans des conditions économiquement raisonnables.
La Cour de cassation répond que, l’Autorité n’a pas sanctionné un refus d’accès à une infrastructure essentielle, mais un abus de position dominante ayant consisté à empêcher des concurrents de répondre à des appels d’offres, en communiquant avec retard, puis de façon incomplète, son offre de référence, nécessaire pour que ses concurrents puissent élaborer leurs réponses aux appels d’offres dans des conditions équitables.
La Cour d’appel a démontré le pouvoir de marché de la société TDF sur le marché de gros amont de l’accès aux infrastructures nécessaires à la diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, lequel résulte :
- de son ancien monopole,
- du contexte de déploiement de la diffusion de la télévision numérique privilégiant le réseau historique de pylônes utilisés pour la diffusion de la télévision analogique,
- des barrières économiques et réglementaires importantes observées à l’entrée de ce marché.
Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel a donc pu retenir le pouvoir de marché de la société TDF sans être tenue d’établir le caractère non réplicable dans des conditions économiquement raisonnables de ces infrastructures.
3 – Sur l’incompétence de l’Autorité de la concurrence au profit de l’ARCEP
Par ailleurs, TDF soutenait que l’Autorité de la concurrence n’était pas compétente pour sanctionner un abus autonome d’un manquement à la réglementation sectorielle, alors même que le régulateur sectoriel, — l’ARCEP — n’avait pas jugé utile de poursuivre TDF pour violation d’une obligation réglementaire de publication.
À cet égard, la Cour de cassation approuve la Cour de Paris d’avoir retenu que l’appréciation de l’autorité de régulation ne saurait lier l’Autorité de la concurrence qui applique une législation différente, ni faire obstacle à la qualification d’abus retenue, de sorte que la procédure en cause n’avait pas pour objet de sanctionner un manquement sectoriel, mais un abus autonome, au sens du droit de la concurrence.
4 – Sur la méthode de calcul de la sanction
Enfin, TDF arguait de la violation par l’Autorité de la concurrence, du principe de la prévisibilité de la sanction. Elle soutenait en effet que l’Autorité se serait écartée de la méthode traditionnelle de calcul prévue au paragraphe 23 du communiqué sanctions, laquelle repose sur la prise en compte, pour le calcul du montant de base de la sanction pécuniaire d’une proportion de la valeur des ventes, au profit de la méthode suivie pour déterminer les sanctions pécuniaires dans le cas de certaines pratiques mises en œuvre à l’occasion d’appels d’offres, prévue aux paragraphes 67 et 68 du même communiqué sanctions, qui permet d’appliquer un coefficient, déterminé en fonction de la gravité des faits et de l’importance du dommage causé à l’économie, au chiffre d’affaires total réalisé en France par l’entreprise en cause.
Relevant que la Cour d’appel de Paris s’est bien assurée que l’Autorité avait suffisamment motivé le recours à une méthode spécifique à des pratiques mises en œuvre à l’occasion d’appel d’offres et que cette application n’était pas inédite, la Cour de cassation retient que le mode de détermination de la sanction infligée à la société TDF était raisonnablement prévisible.
5 – Sur l’imputation de la sanction aux 2 sociétés mères
Enfin, la Chambre commerciale de la Cour de cassation approuve l’imputation aux deux sociétés mères du comportement de leur filiale, société dont elles détenaient la totalité ou la quasi-totalité du capital. Elle estime à cet égard que la seule invocation de leur qualité de sociétés holding financières n’est assurément pas de nature à renverser la présomption réfragable.
Découvrez nos services et outils associés

Réseaux de distribution, Concurrence
Assigner ou se défendre contre un distributeur
Un litige vous oppose à un ou plusieurs de vos distributeurs ?
En matière économique, du fait de l’importance du facteur temps, il est souvent primordial de trouver rapidement un arrangement acceptable.
Avocats de réseaux de distribution, notre approche du contentieux réside en premier lieu dans la prévention et l’anticipation de ceux-ci.
Quand survient un contentieux, notre connaissance des réseaux de distribution et du droit de la distribution nous permet d’être très pro actifs à vos côtés pour la recherche et la production des preuves pertinentes.
Un litige vous oppose à un ou plusieurs de vos distributeurs ?
En matière économique, du fait de l’importance du facteur temps, il est souvent primordial de trouver rapidement un arrangement acceptable.
Avocats de réseaux de distribution, notre approche du contentieux réside en premier lieu dans la prévention et l’anticipation de ceux-ci.
Quand survient un contentieux, notre connaissance des réseaux de distribution et du droit de la distribution nous permet d’être très pro actifs à vos côtés pour la recherche et la production des preuves pertinentes.
Et les ressources sur le même thème : "Contrôles Autorité de la concurrence – DGCCRF"
Relations clients fournisseurs
« Taxe Lidl » : rejet du pourvoi du Ministre
Entre 2013 et 2015, les conventions annuelles conclues entre le Galec – la Société coopérative groupements d’achats des centres Leclerc – et certains fournisseurs nationaux prévoyaient que, lorsque les produits qu’elle référençait l’étaient également par la société Lidl, il…
Réseaux de distribution, Concurrence
La Cour de cassation précise les critères du dénigrement constitutif d’un abus de position dominante
Dans l’Affaire Lucentis/Avastin, La Chambre commerciale vient de rendre un arrêt intéressant qui redéfinit les contours du dénigrement constitutif d’un abus de position dominante.
Relations clients fournisseurs
Conformité de l’article L. 441-17 du code de commerce à la Constitution
Le Conseil constitutionnel dit conforme à la Constitution l’article L. 441-17 du code de commerce qui ne définit pas la notion de « marge d’erreur suffisante ». La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, dite « EGAlim 2 » a introduit au Code de commerce et au Code rural et de la pêche mar…
Produits, Consommation, Publicité
Qu'est-ce que la shrinkflation ?
Ce terme provient de la contraction du mot inflation et du verbe anglais shrink, qui signifie rétrécir. Il s’agit d’une pratique commerciale, et une technique de marketing, également qualifiée de « réduflation », consistant à réduire la taille d’un produit, tout en maintenant, voir en augmen…