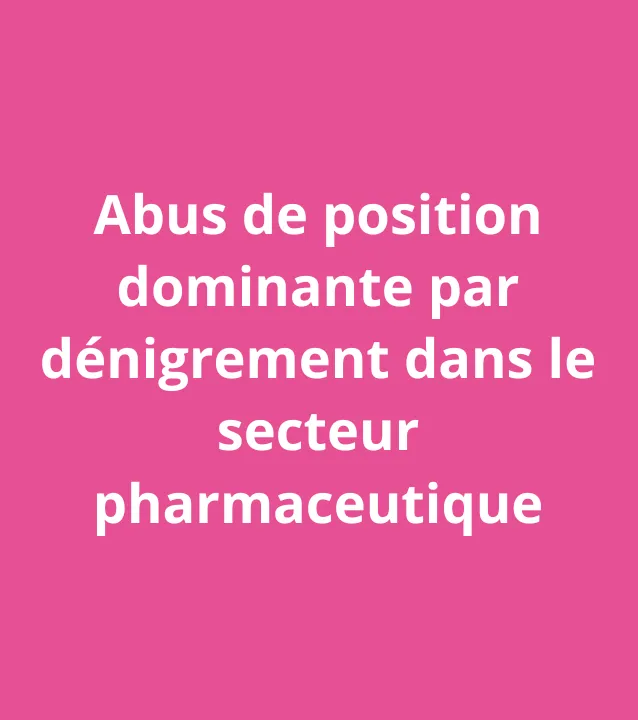Analyse des sanctions récentes en droit de la concurrence
Le droit de la concurrence joue un rôle central dans la régulation des marchés en garantissant l’équité et la transparence entre les acteurs économiques. Ces dernières années, tant en France qu’au niveau européen, les autorités de concurrence ont intensifié leur vigilance et prononcé des sanctions significatives à l’encontre d’entreprises pour pratiques anticoncurrentielles. Qu’il s’agisse d’abus de position dominante ou d’ententes, ces mesures illustrent la volonté des régulateurs de préserver un marché compétitif au profit des consommateurs et des entreprises innovantes.
La présente analyse porte sur les principales décisions récentes, leurs motivations et les impacts qu’elles engendrent sur le paysage concurrentiel national et européen, dans un contexte économique en constante évolution.
Sur le plan français
Les sanctions en France ont connu en 2024 un niveau exceptionnel, avec des montants historiques dans plusieurs affaires majeures.
L’Autorité de la concurrence a publié le détail du montant total des sanctions qu’elle a pu infliger ces dix dernières années dans son rapport annuel de 2024 :
|
Années |
Evolution des sanctions pécuniaires après recours (en millions d’euros) |
|
2024 |
1 427,7 |
|
2023 |
167,6 |
|
2022 |
467,9 |
|
2021 |
873,5 |
|
2020 |
463,1 |
|
2019 |
587,9 |
|
2018 |
236,2 |
|
2017 |
493,8 |
|
2016 |
192,5 |
|
2015 |
1.135,2 |
|
2014 |
936,0 |
Source : Rapport annuel de 2024 de l’Autorité de la concurrence
Le fossé entre le montant total des sanctions infligées en 2023 et en 2024 est frappant. En 2023, le montant total des sanctions imputées s’élevait à 167,6 millions d’euros, tandis qu’en 2024, sur huit décisions de sanctions (6 ententes, 1 abus de position dominante et 1 obstruction lors des OVS), un total de 1,42 milliard d’euros d’amende aura été infligé aux entreprises sanctionnées.
Les décisions françaises rendues en 2024
Les décisions les plus marquantes de 2024 près l’Autorité sont sans nul doute au nombre de trois :
- La décision 24-D-11 avec une sanction de 611 millions d’euros infligée à dix fabricants et deux distributeurs de produits électroménagers.
Dans cette décision, l’Autorité sanctionne, d’une part, dix fournisseurs pour avoir, chacun, mis en œuvre une entente généralisée avec ses distributeurs pour fixer, directement ou indirectement, le prix de vente au détail de ses produits et, d’autre part, deux distributeurs pour avoir chacun mis en œuvre une entente généralisée avec ses fournisseurs aux mêmes fins. Ces pratiques avaient été révélées par une demande de clémence mais, à l’exception d’échanges d’informations entre les fabricants, pour lesquels le grief n’a pas été retenu par le collège, l’entente entre les fabricants a fait l’objet d’une précédente décision d’interdiction (Autorité de la concurrence, Décision n° 18-D-24, 5 décembre 2018). Dix entreprises, à l’exception de Boulanger et SEB, ont décidé de ne pas contester les griefs.
Cette décision, mis à part le montant exceptionnel de l’amende infligé, a notamment fait application de la jurisprudence Sumal (CJUE, 6 oct. 2021, aff. C-882/19) et L’Oréal (CA de Paris,18 juin 2020, n° 19/08826, points 67 à 79) sur la responsabilité descendante des sociétés. En effet, l’Autorité a rappelé qu’il était possible, à certaines conditions, de retenir dans le périmètre de la valeur des ventes pour le calcul de la sanction pécuniaire celle réalisée par une société non destinataire de la notification de griefs mais qui s’avère être la filiale d’une société mère, auteur direct d’une infraction au droit de la concurrence ou société mère d’une autre société filiale elle-même auteur direct. A ce titre, l’Autorité a mis en cause les sociétés Darty Grand Est SNC, en qualité de sociétés dont l’activité économique a présenté, au cours de l’infraction, un lien concret avec l’objet de cette dernière, et Darty Grand Ouest SNC, en qualité de successeur de Darty Provence Méditerranée, Darty Alsace Lorraine et Darty Nord dont l’activité économique a présenté, au cours de l’infraction, un lien concret avec l’objet de cette dernière.
- La décision 24-D-09 dans laquelle l’Autorité a sanctionné à hauteur de 470 millions d’euros les fabricants Schneider Electric et Legrand et les distributeurs Rexel et Sonepar.
Aux termes de cette décision, deux fabricants de matériel électrique basse tension, les sociétés Schneider Electric et Legrand, en collaboration avec leurs distributeurs Rexel et Sonepar, ont été sanctionnés par l’Autorité pour avoir participé à deux ententes verticales distinctes portant sur la fixation des prix de revente. La première entente, entre Schneider Electric et ses distributeurs Rexel et Sonepar, s’est déroulée de décembre 2012 à septembre 2018. La seconde, entre Legrand et Rexel, s’est déroulée de mai 2012 à septembre 2015.
Dans le secteur du matériel électrique basse tension, les fabricants et les distributeurs concluent des contrats-cadres annuels à l’issue de négociations commerciales. En pratique, les clients finaux sollicitent souvent des prix inférieurs à ces prix tarifs standards, et s’adressent pour cela directement aux fournisseurs. Afin de répondre à cette demande sans que les distributeurs soient contraints de revendre à perte, les contrats-cadres prévoyaient un mécanisme d’ajustement de prix pour les distributeurs, leur permettant d’obtenir un prix d’achat « dérogé », obtenu sous forme d’un avoir, afin de s’aligner sur le prix demandé par le client final et d’offrir le cas échéant des réductions supplémentaires.
L’Autorité a constaté que les pratiques mises en œuvre par les fabricants et les distributeurs en cause avaient conduit, en réalité, à fixer les prix de vente aux clients finaux, réduisant ainsi la liberté tarifaire des distributeurs. Cette entente a eu pour effet de restreindre la concurrence entre eux, contribuant au maintien artificiel de prix élevés sur le marché français. Les éléments en présence ont révélé que les prix dérogés, bien que présentés comme « maximums » ou « conseillés », étaient en réalité prédéterminés par Schneider Electric et Legrand comme des prix fixes, dépourvus de toute marge de négociation réelle pour les distributeurs.
Cette décision s’inscrit, en réalité, dans la continuité de la jurisprudence de l’Autorité en matière de fixation verticale des prix de revente (V. par exemple les ententes verticales suivantes sanctionnées : Décision 23-D-13 du 19 décembre 2023 ; Décision 23-D-12 du 11 décembre 2023 ; Décision 21-D-26 du 08 novembre 2021). Elle montre qu’une organisation tarifaire, même inhabituelle dans le cadre de relations contractuelles tripartites entre fournisseur, distributeur et client final, peut néanmoins constituer une entente verticale anticoncurrentielle entre fournisseur et distributeur. Le fait que cette organisation résulte d’une sollicitation directe du client final auprès du fournisseur, afin de traiter un « marché particulier », ne permet pas de légitimer l’intervention du fournisseur dans la fixation du prix de revente appliqué par le distributeur.
- La décision 24-D-03 au cours de laquelle l’Autorité a prononcé une sanction de 250 millions d’euros à l’encontre de Google pour non-respect de certains de ses engagements pris en juin 2022.
Cette décision est un nouvel épisode de l’affaire dite des droits voisins, qui oppose les éditeurs de presse à Google. À l’issue d’une procédure de transaction, Google est condamné pour non-respect des engagements pris dans la décision n° 22-D-13 du 21 juin 2022, décision d’acceptation d’engagements qui faisait elle-même suite à une décision de mesures conservatoires. En effet, Google avait déjà été contraint par l’Autorité à négocier de bonne foi les conditions d’une rémunération pour l’utilisation, sur sa plateforme, des contenus des éditeurs de presse. Dans la décision 24-D-03, l’Autorité sanctionne Google pour avoir, notamment, méconnu son engagement de coopération avec le mandataire, le cabinet Accuracy en charge du suivi et du contrôle de la mise en œuvre des engagements pris par Google, et pour ne pas avoir respecté quatre de ses sept engagements, dont l’objectif était de garantir les principes suivants :
- Conduire des négociations de bonne foi, sur la base de critères transparents, objectifs et non discriminatoires dans un délai de trois mois (engagements n°1 et 4) ;
- Transmettre aux éditeurs ou agences de presse les informations nécessaires à l’évaluation transparente de leur rémunération au titre des droits voisins (engagement n°2) ;
- Prendre les mesures nécessaires pour que les négociations n’affectent pas les autres relations économiques existant entre Google et les éditeurs ou agences de presse (engagement n°6).
La décision revêt un intérêt particulier par ses développements concernant l’intégration de l’intelligence artificielle. Lors du déploiement de Bard puis de Gemini, plusieurs manquements ont été constatés : l’Autorité considère que Google aurait dû avertir les éditeurs et agences de presse de l’exploitation de leurs contenus par son IA et mettre à leur disposition un dispositif technique leur permettant de s’y opposer.
Les décisions françaises rendues en 2025
Concernant 2025, les sanctions infligées par l’Autorité sont supérieures à celles de 2023, puisque nous sommes déjà à un total de 179,5 millions d’euros imputé dans le cadre de deux décisions :
- Une sanction globale de 29,5 millions d’euros dans la décision 25-D-03 concernant deux ententes distinctes entre Ausy (devenu Randstad Digital) et Alten d’une part, et Expleo et Bertrandt d’autre part, pour avoir mis en place des accords généraux de non-débauchage.
Plus précisément, deux ententes bilatérales sont en l’espèce sanctionnées par l’Autorité :
- La première, entre la société Ausy, le demandeur de clémence, et la société Alten, porte sur un accord de non-débauchage prenant la forme d’un gentlemen’s agreement visant à s’interdire mutuellement de solliciter et d’embaucher leur personnel respectif, paramètre de concurrence essentiel sur les marchés du travail sur lesquels sont actives les entreprises mises en cause. Cet accord présente un caractère général et concerne un certain type de salariés cadres des entreprises sanctionnées, les « business managers » (grief n° 1). L’ accord entre Ausy et Alten, avait été mis en œuvre pendant presque 10 ans, entre 2007 et 2016. Il est également reproché aux deux société d’avoir procédé à des échanges d’informations concernant la mobilité ou les projets de mobilité de leur personnel. L’Autorité balaye l’argument des parties consistant à dire que ces accords servaient à prévenir un acte de concurrence déloyale ou une problématique de désorganisation massive des équipes, dès lors qu’il visait à empêcher tout recrutement respectif de business managers, même lorsqu’il s’agissait d’un seul collaborateur (« un Commercial », « quelques CVS commerciaux » ou « l’un de nos managers »). L’Autorité a notamment constaté que le champ d’application de l’accord n’est pas limité dans sa durée et s’applique à tous les business managers, indépendamment de la mission à laquelle ils sont affectés et du client pour lequel ils interviennent. Dans ce contexte, l’accord litigieux visait bien à s’entendre sur un paramètre de concurrence entre les entreprises, au détriment de leur personnel.
- La seconde a également pris la forme d’un gentlemen’s agreement général sur le non-débauchage entre les sociétés Expleo et Bertrandt, en dehors de tout contrat de partenariat entre les entreprises sanctionnées (grief n° 2). L’Autorité a constaté le caractère général et non limité de ce « gentleman agreement », notamment s’agissant des personnes concernées, les « employés » ou les « fournisseurs », les « collaborateurs ou S/T [sous-traitants] » ainsi que les « effectifs en propre et les Rangs 2 et intérimaires ». L’accord entre le Groupe Expleo et Bertrandt consistait à s’accorder pour renoncer à recruter leur personnel respectif, que ce soit sur sollicitation de l’entreprise ou à la suite d’une candidature spontanée, en se concertant lorsque des mouvements étaient en projet. Ces pratiques, en tant qu’elles constituent un accord ayant pour objet la répartition de sources d’approvisionnement figurent parmi les ententes anticoncurrentielles expressément citées par les dispositions de l’article 101, paragraphe 1, sous c) du TFUE et de l’article L. 420-1, 4° C.com. Elles sont considérées, aux termes d’une jurisprudence constante, comme constituant « des violations particulièrement graves de concurrence » et ayant « un objet restrictif de la concurrence en [elles]-mêmes », cette analyse ayant en outre été confirmée par la Cour de justice précisément au sujet d’accords de non-débauchage.
Contrairement à la clause de non-concurrence, qui limite les droits du salarié après la fin de son contrat de travail, la clause de non-débauchage, aussi appelée accord de non-sollicitation, est conclue entre deux entreprises afin d’interdire à chacune d’elles de recruter les salariés de l’autre. Cette clause peut être intégrée dans un contrat commercial ou, comme dans ce cas précis, consiste en un accord oral ou informel s’appliquant à l’ensemble des salariés, sans restriction de durée ni de zone géographique.
Cette décision envoie un message clair : le marché du travail entre pleinement dans le champ d’application du droit de la concurrence. Lorsqu’un accord entre deux entreprises interdit mutuellement à chacune de recruter les salariés de l’autre, cela fausse la concurrence entre employeurs, limite la mobilité des salariés, et expose les parties à des sanctions sévères.
Cette décision est inédite en ce qu’elle sanctionne des accords de non-débauchage conclus de manière autonome, c’est-à-dire sans être intégrés à une autre entente, comme un cartel de fixation des prix.
- Une amende à hauteur de 150 millions dans la décision 25-D-02 infligée à la société Apple, pour avoir, entre avril 2021 et juillet 2023, abusé de sa position dominante dans le secteur de la distribution d’applications mobiles sur les terminaux iOS et iPadOS.
En avril 2021, Apple a introduit avec la version 14.5 d’iOS et d’iPadOS un dispositif appelé App Tracking Transparency (ATT). Ce mécanisme vise à renforcer la protection de la vie privée des utilisateurs en les informant via une fenêtre standardisée et en leur demandant leur consentement avant que les applications mobiles ne collectent leurs données sur des apps tierces de l’écosystème Apple. Ce consentement, requis dès la première utilisation après téléchargement depuis l’App Store, autorise l’application à accéder à l’identifiant publicitaire du terminal, l’IDFA, qui permet de suivre l’activité de l’utilisateur à travers différentes applications et sites externes à l’appareil.
En anticipation du lancement par Apple du dispositif ATT, plusieurs associations représentant les acteurs de la publicité en ligne, tels que les médias, régies internet, agences de publicité, intermédiaires techniques, éditeurs et agences de marketing mobile, avaient saisi l’Autorité de la concurrence en octobre 2020. Dans sa décision du 17 mars 2021, l’Autorité a choisi de ne pas imposer de mesures conservatoires, indiquant que l’examen au fond de l’affaire devait se poursuivre.
L’Autorité a constaté que le dispositif ATT imposé par Apple n’est pas nécessaire, dans la mesure où il ne permet pas le recueil d’un consentement valable au regard du droit applicable tel qu’il résulte, notamment de la loi Informatique et Libertés. Par ailleurs, les règles encadrant l’interaction entre les différentes fenêtres ainsi affichées portent atteinte à la neutralité du dispositif. Enfin, l’Autorité a constaté une asymétrie de traitement entre celui qu’Apple se réservait et celui qu’elle appliquait aux éditeurs.
Cette affaire illustre une nouvelle collaboration entre l’Autorité de la concurrence et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). En effet, l’Autorité a pris en compte deux avis émis par la CNIL autour des questions d’application de la législation sur la protection de la vie privée soulevées par ce dossier, intégrant ces éléments dans son analyse concurrentielle. Elle démontre ainsi que le droit de la concurrence et la protection de la vie privée ne sont pas antagonistes, mais au contraire convergent pour garantir un marché transparent et équitable, préservant les intérêts et le bien-être des consommateurs.
Les perspectives futures du contrôle des pratiques concurrentielles en France
Pour le reste de l’année 2025, ainsi que l’année 2026, l’Autorité nous a informé des grandes orientations qui guideront son intervention dans sa Feuille de route, publiée le 10 juillet dernier. Celles-ci peuvent se résumer de la manière suivante :
- Préserver l’ouverture et l’équité des marchés numériques: l’Autorité s’attache, depuis longtemps, à prendre en compte les spécificités des marchés numériques et cette action demeurera une priorité. L’Autorité examine actuellement une demande de mesures conservatoires dans le secteur des moteurs de recherche. Elle se tient également prête à exercer les pouvoirs d’enquête qui lui ont été conférés par la loi du 21 mai 2024 (loi n° 2024-449) en vue de la mise en œuvre du règlement européen sur les marchés numériques.
- Poursuivre l’intégration de l’impératif de durabilité à la politique de concurrence: l’Autorité est déterminée à sanctionner les pratiques qui priveraient les consommateurs de leur capacité à effectuer un choix éclairé quant aux caractéristiques des produits et services liées au développement durable. Elle s’appuiera notamment sur son avis de janvier 2025 relatif aux systèmes de notation environnementale des produits et des services de consommation.
- Soutenir le pouvoir d’achat: après le choc inflationniste de 2022-2023, le repli de l’inflation en 2024 a permis au pouvoir d’achat des ménages de recommencer à progresser. Toutefois, l’impact sur les ménages demeure durable, la vigilance reste donc de mise pour protéger le pouvoir d’achat.
Ces deux dernières années confirment, ainsi, un durcissement des sanctions avec une vigilance accrue de l’Autorité aux nouveaux enjeux du marché (dématérialisation, plateformes, développement durable). Les décisions phares rappellent l’importance du dispositif dissuasif, la diversité des secteurs concernés et l’incitation à la conformité et à la prévention des risques.
Sur le plan européen
L’affaire la plus marquante concerne Meta (regroupant Facebook, Instagram et WhatsApp), sanctionné en novembre 2024 par la Commission européenne à hauteur de 798 millions d’euros pour avoir lié son service de petites annonces en ligne Facebook Marketplace à son réseau social Facebook et pour avoir imposé des conditions commerciales déloyales à d’autres fournisseurs de services de petites annonces en ligne. (Commission européenne, 14 novembre 2024, n° AT.40684, Facebook Marketplace)
Cette décision illustre la sévérité croissante envers les pratiques anticoncurrentielles dans les secteurs numériques et constitut la septième plus grosse amende infligée par l’Union européenne pour des pratiques anticoncurrentielles (hors cas de cartels).
Toutefois, sur les pratiques anticoncurrentielles, Google reste le plus sanctionné au niveau européen, avec un total d’environ 8 milliards d’euros d’amendes, dont une amende record de 4,34 milliards d’euros :
- Le 5 septembre 2025, la Commission européenne a annoncé avoir sanctionné Google à hauteur de 2,95 milliards d’euros pour avoir abusé de sa position dominantedans le secteur de la publicité en ligne (affaire dite « Adtech », numéro de l’affaire non communiqué à ce jour). Plus précisément, il est reproché à Google d’avoir commis cette infraction en favorisant ses propres services de technologie d’affichage publicitaire en ligne au détriment des fournisseurs concurrents de services de technologie publicitaire, des annonceurs et des éditeurs en ligne. La Commission a ordonné à Google : 1) de mettre fin à ces pratiques d’auto-préférence ; et 2) de mettre en œuvre des mesures visant à mettre un terme à ses conflits d’intérêts inhérents tout au long de la chaîne de fourniture « Adtech ». Le géant américain dispose de 60 jours pour informer la Commission de la manière dont elle entend procéder.
- Dans la décision « AdSense » de la Commission européenne (40411, 20 juin 2019), une amende initiale de 1,49 milliard d’euros a été imputée à Google, lui reprochant à d’avoir abusé de sa position dominante sur le marché en imposant un certain nombre de clauses restrictives dans les contrats passés avec des sites web tiers, empêchant ainsi ses concurrents de placer leurs publicités contextuelles sur ces sites. Toutefois, cette décision a été annulée partiellement par le Tribunal de l’Union européenne (TUE, 18 septembre 2024, T-334/19), au motif notamment que la Commission a omis de prendre en considération l’ensemble des circonstances pertinentes dans son appréciation de la durée des clauses contractuelles qu’elle avait qualifiées d’abusives.
Dans des décisions et arrêts plus anciens s’agissant de Google :
Dans la décision « Androïd » de la Commission européenne (AT.40099, 18 juillet 2018), où près de 4,34 milliards d’euros d’amende pour pratiques anticoncurrentielles liées à l’imposition d’applications ont été infligés à Google. La décision de la Commission porte sur trois types spécifiques de restrictions contractuelles imposées par Google aux fabricants d’appareils et aux opérateurs de réseaux mobiles. Ces restrictions ont permis à Google d’utiliser Android comme un véhicule pour consolider la position dominante de son moteur de recherche. La Commission conclut, dans sa décision, que Google occupe une position dominante sur les marchés des services de recherche générale sur l’internet, des systèmes d’exploitation mobiles intelligents sous licence et des boutiques d’applications en ligne pour le système d’exploitation mobile Android.
- Dans la décision « Google Shopping », la Commission européenne (39740, 27 juin 2017) a imputé une amende d’d’environ 2,4 milliards d’euros à Google pour avoir abusé de sa position dominante sur plusieurs marchés nationaux de la recherche sur Internet en favorisant son propre service de comparaison de produits par rapport à celui de ses concurrents. Le Tribunal de l’Union européenne ayant, en substance, confirmé cette décision et maintenu cette amende, Google et Alphabet ont introduit un pourvoi devant la Cour, qui a rejeté celui-ci et confirme ainsi l’arrêt du Tribunal (CJUE, 10 septembre 2024, C-48/22 P).
Cette saga Google illustre parfaitement la lutte constante et déterminée que mènent les autorités de concurrence, tant françaises qu’européennes, contre les entreprises occupant des positions dominantes sur des marchés en forte croissance. Ces autorités déploient des moyens renforcés et coordonnés pour détecter, poursuivre et sanctionner les comportements anticoncurrentiels, témoignant ainsi de leur engagement à préserver la dynamique concurrentielle et à garantir des conditions équitables pour l’ensemble des acteurs économiques.
Pour achever notre analyse des sanctions au niveau européen, dans une affaire récente, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé la sanction à hauteur de 33,6 millions d’euros contre HSBC Holdings infligée par la Commission européenne en 2021 (Commission européenne, 28 juin 2021, AT.39914), pour sa participation à des ententes sur le marché des produits dérivés financiers. Cette jurisprudence confirme la tendance à la fermeté, y compris contre les grandes institutions financières (TUE, 27 novembre 2024, T-561/21). Dans cet arrêt, le Tribunal rejette le recours en annulation introduit par les entités HSBC, contre la décision de la Commission modifiant sa décision d’infliger une amende de 33 606 000 euros à HSBC pour infraction unique et continue ayant eu pour objet l’altération du cours normal de fixation des prix sur le marché des produits dérivés de taux d’intérêt en euro.
La période récente est ainsi caractérisée par une accentuation des sanctions européennes dans le numérique et le secteur financier. Les juridictions européennes confirment la fermeté de la Commission et encouragent de nouvelles réformes pour accélérer l’action, cibler les comportements nouveaux (collusion algorithmique, licences dans l’IA) et renforcer la dissuasion, en particulier dans les enquêtes visant les grandes entreprises.
Le cabinet vous accompagne dans toutes vos démarches juridiques et reste à votre disposition pour répondre à vos questions. N’hésitez pas à nous contacter pour bénéficier d’un conseil personnalisé et adapté à votre situation.
Découvrez nos services et outils associés

Réseaux de distribution, Concurrence
Programmes de conformité concurrentielle
Le droit de pratiques anticoncurrentielles constitue un enjeu majeur pour les entreprises.
Le contrôle de la concurrence et les prérogatives des autorités communautaires de l’Autorité de la concurrence se sont accrus.
Le montant des sanctions s’est accru, et le risque est majeur, des solutions alternatives aux procédures contentieuses (clémence, transaction, engagements) s’étant toutefois développées en permettant d’offrir des outils de gestion de risque additionnels.
Le droit de pratiques anticoncurrentielles constitue un enjeu majeur pour les entreprises.
Le contrôle de la concurrence et les prérogatives des autorités communautaires de l’Autorité de la concurrence se sont accrus.
Le montant des sanctions s’est accru, et le risque est majeur, des solutions alternatives aux procédures contentieuses (clémence, transaction, engagements) s’étant toutefois développées en permettant d’offrir des outils de gestion de risque additionnels.

Réseaux de distribution, Concurrence
Contrôle et contentieux de la concurrence
Vous devez faire face à un litige devant la DGCCRF, l'autorité de la Concurrence ou la Commission Européenne pour une problématique relative au droit de la concurrence ?
Gouache Avocats assiste ses clients depuis l'opération de visite et de saisie jusqu'à une éventuel contentieux devant les juridictions françaises ou communautaires.
Vous devez faire face à un litige devant la DGCCRF, l'autorité de la Concurrence ou la Commission Européenne pour une problématique relative au droit de la concurrence ?
Gouache Avocats assiste ses clients depuis l'opération de visite et de saisie jusqu'à une éventuel contentieux devant les juridictions françaises ou communautaires.

Réseaux de distribution, Concurrence
Ententes
Le Cabinet Gouache Avocats vous conseille sur la licéité de vos accords et pratiques au regard de la réglementation française et communautaire de la concurrence et dans la mise en place de programme de conformité (« compliance programs ») au sein de votre entreprise.
Le Cabinet Gouache Avocats accompagne également les entreprises dans le cadre de procédures engagées par l’Autorité de la concurrence ou la Commission européenne (demande de renseignements, visites et saisies, procédures de clémence, transaction, engagements), de contentieux devant les juridictions nationales et communautaires et assiste les entreprises souhaitant se plaindre d’éventuelles ententes anticoncurrentielles dans leur secteur d’activité.
Gouache avocats vous accompagne pour évaluer votre risque et vous défendre.
Le Cabinet Gouache Avocats vous conseille sur la licéité de vos accords et pratiques au regard de la réglementation française et communautaire de la concurrence et dans la mise en place de programme de conformité (« compliance programs ») au sein de votre entreprise.
Le Cabinet Gouache Avocats accompagne également les entreprises dans le cadre de procédures engagées par l’Autorité de la concurrence ou la Commission européenne (demande de renseignements, visites et saisies, procédures de clémence, transaction, engagements), de contentieux devant les juridictions nationales et communautaires et assiste les entreprises souhaitant se plaindre d’éventuelles ententes anticoncurrentielles dans leur secteur d’activité.
Gouache avocats vous accompagne pour évaluer votre risque et vous défendre.

Et les ressources sur le même thème : "Programmes de conformité concurrentielle"
Réseaux de distribution, Concurrence
La Cour de cassation précise les critères du dénigrement constitutif d’un abus de position dominante
Dans l’Affaire Lucentis/Avastin, La Chambre commerciale vient de rendre un arrêt intéressant qui redéfinit les contours du dénigrement constitutif d’un abus de position dominante.
Réseaux de distribution, Concurrence
Droit de la concurrence : comment protéger son entreprise ?
Pour protéger une entreprise en droit de la concurrence, il est essentiel de comprendre les pratiques prohibées et les mécanismes de défense et de prévention.
Réseaux de distribution, Concurrence
Cautionnement disproportionné: à qui la charge de la preuve?
La Cour de cassation précise à qui incombe la charge de la preuve lorsqu’il est invoqué un cautionnement disproportionné. Il est fréquent dans les réseaux de distribution que les enseignes sollicitent des engagements de cautions à leur profit. Ces engagements peuvent être pris par le dirige…