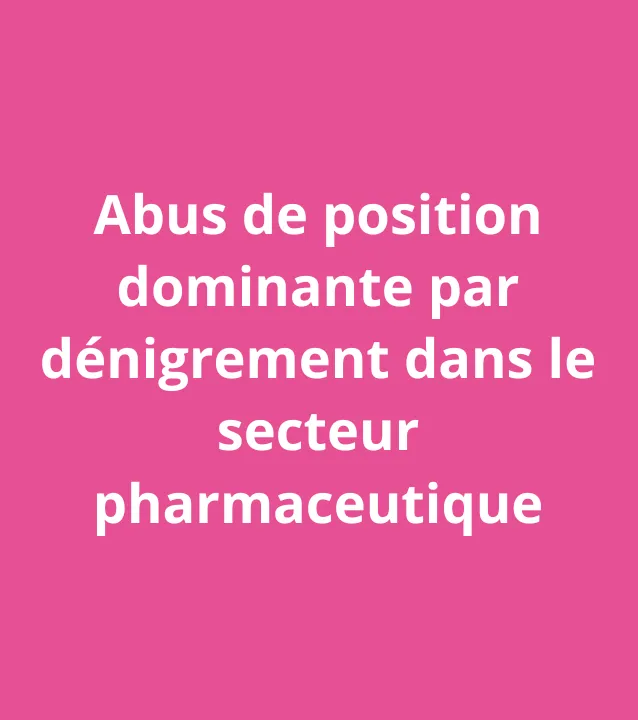Droit de la concurrence : comment protéger son entreprise ?
La concurrence constitue l’un des fondements du bon fonctionnement des marchés, en incitant les acteurs économiques à innover, à améliorer la qualité de leurs produits et services, et à proposer des prix compétitifs. Cependant, certaines pratiques, qu’elles émanent de concurrents ou de partenaires commerciaux, peuvent fausser ce jeu concurrentiel et mettre gravement en danger l’activité d’une entreprise.
Pour se protéger efficacement, il est indispensable de comprendre à la fois les comportements sanctionnés par le droit de la concurrence (I.), et les outils de contrôle et de répression mis en œuvre par les autorités compétentes (II.), afin de mettre en place des programmes adaptés (III.).
I. Identification des pratiques anticoncurrentielles prohibées
Avant de pouvoir adopter une stratégie efficace de protection, il est essentiel d’identifier les comportements susceptibles d’entraver le libre jeu de la concurrence, tels qu’ils sont définis et interdits par le droit. Ces pratiques sont : les ententes illicites (A), les abus de position dominante (B), l’abus d’un état de dépendance économique (C), ainsi que les pratiques restrictives de concurrence (D), et font l’objet d’une réglementation précise, tant au niveau national (Livre IV du code de commerce, ci-après « C. com. ») qu’européen (articles 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, ci-après « TFUE »). Dès lors, une analyse approfondie de leur nature et de leur typologie s’impose comme préalable à toute démarche de sécurisation de l’entreprise face aux risques concurrentiels.
Les ententes (articles L. 420-1 C. com. et 101 TFUE)
Sont prohibées les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions qui ont « pour objet » ou peuvent avoir « pour effet » d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.
La distinction entre restrictions « par objet » et « par effet » est particulièrement significative sur le plan probatoire : lorsqu’une restriction est qualifiée « par objet », les autorités de concurrence sont dispensées d’établir son impact concret sur le marché, alors qu’une restriction « par effet » nécessite une démonstration détaillée de ses conséquences. Cette présomption de nocivité s’appuie sur la gravité intrinsèque de la pratique et sur l’expérience jurisprudentielle acquise. Par ailleurs, une restriction identifiée « par objet » est réputée sensible et peut être sanctionnée indépendamment de toute preuve d’un effet notable. Ce mécanisme allège donc la charge de la preuve pesant sur les autorités de concurrence.
Il existe plusieurs formes d’entente anticoncurrentielle :
- Les ententes horizontales : elles interviennent entre entreprises concurrentes opérant au même niveau de la chaîne économique. Les exemples incluent :
- La fixation en commun des prix.
- La répartition de marchés ou de clientèles [1].
- La soumission concertée à des appels d’offres (trucage d’offres) [1].
- Les ententes verticales : elles interviennent entre entreprises situées à des niveaux différents de la chaîne économique (exemple : un fournisseur et ses distributeurs). Elles peuvent être prohibées si elles restreignent la concurrence, par exemple en imposant un prix de revente ou en limitant la liberté commerciale du distributeur. C’est à ce titre que les réseaux de distribution sont concernés, ces accords portent sur les conditions d’achat, de vente ou de revente de biens ou services au sein du réseau de distribution. Ils sont très fréquents dans les contrats de distribution, comme la distribution exclusive, sélective ou la franchise, et peuvent contenir des clauses susceptibles de restreindre la concurrence, ce qui les soumet au contrôle du droit de la concurrence. En effet, l’Autorité de la concurrence a déjà sanctionné des cas d’ententes verticales entre un franchiseur et ses franchisés [2]. Néanmoins, dans le cadre de la double distribution, qui combine l’achat-revente et la vente directe, le réseau génère des restrictions de concurrence qui ne sont plus uniquement verticales et peuvent être également horizontales. La double distribution introduit une dose de restriction horizontale susceptible de bouleverser l’analyse concurrentielle classiquement retenue de l’accord. La Commission a intégré cet élément au sein du Règlement 2022/720, dans lequel elle exempte l’échange qui « est à la fois directement lié à la mise en œuvre de l’accord vertical et nécessaire pour améliorer la production ou la distribution de biens ou services contractuels» (Règlement UE 2022/720, 10 mai 2022, considérant 13).
Une pratique d’entente peut être exemptée si elle remplit les conditions cumulatives. Il existe, à ce titre, deux types d’exemption.
- Exemption catégorielle par règlements d’exemption
L’exemption catégorielle est une exemption collective prévue par voie de règlements, pour les accords verticaux il s’agit du règlement (UE) 2022/720, quant aux accords horizontaux il s’agit des règlements 2023/1066 (sur la R&D horizontale) et 2023/1067 (sur la spécialisation horizontale).
Cette exemption concerne des catégories d’accords spécifiques qui respectent certaines conditions, comme des seuils de parts de marché (maximum 30% pour les parties concernées), et l’absence de clauses dites « noires » qui restreignent gravement la concurrence (exemples : prix minimum, protection territoriale absolue). Cette exemption permet une présomption de légalité et crée une sphère de sécurité (« safe harbor ») pour des accords qui s’inscrivent dans ces critères, facilitant ainsi le développement de réseaux contractuels sans appel systématique à une autorisation individuelle. L’objectif est de réduire la charge administrative et d’encourager la mise en place de réseaux commerciaux structurés (distribution sélective, exclusive, etc.) dans un cadre clair et sécurisé.
- Exemption individuelle
L’exemption individuelle est un mécanisme par lequel une entreprise évalue elle-même si son accord, bien que potentiellement restrictif, remplit les conditions de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, et de l’article L.420-4 du code de commerce, à savoir un accord : « qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ». C’est à l’entreprise qui réclame le bénéfice de cette exemption démontrer que les conditions sont bien remplies.
La démonstration du bénéfice d’une exemption individuelle consiste en une mise en balance des aspects restrictifs de concurrence des accords concernés avec leurs effets pro-compétitifs, qui doivent les compenser. Cette appréciation doit s’opérer notamment en tenant compte du contexte de l’entente en cause
- Recommandation : privilégier l’exemption catégorielle pour développer un réseau
Pour développer un réseau commercial, il est recommandé de structurer les accords de manière à respecter les conditions des règlements d’exemption par catégories d’accords afin de bénéficier de la présomption de légalité. Cela réduit les risques juridiques et le besoin de recours à des exemptions individuelles longues et incertaines. Ce positionnement sécurise les relations contractuelles dans le réseau, notamment par des clauses compatibles avec les règles sur la concurrence, des parts de marché maîtrisées, et une fameuse attention portée aux clauses restrictives (éviter les clauses noires). En résumé, l’exemption catégorielle offre un cadre juridique plus souple et prévisible, idéal pour structurer et faire croître un réseau, tandis que l’exemption individuelle est une procédure plus lourde et risquée, à réserver aux cas où l’exemption catégorielle ne s’applique pas.
L’abus de position dominante (articles 420-2 C. com. et 102 TFUE)
Cette interdiction vise le comportement d’une entreprise détenant une position de force sur un marché qui lui permet de s’abstraire de la concurrence. La protection de l’entreprise implique ici de s’assurer, si elle est en position dominante, de ne pas commettre d’abus, ou si elle en est victime, de savoir les identifier.
La notion d’exploitation abusive d’une position dominante est une notion objective qui vise les comportements d’une entreprise dans une telle position qui sont de nature à influencer la structure d’un marché où, à la suite précisément de la présence de l’entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence. [3]
Trois conditions doivent être réunies pour qu’il existe un abus de position dominante : l’existence d’une position dominante sur un marché déterminé, dit « marché pertinent », une exploitation abusive de cette position, et un objet ou un effet, au moins potentiel, restrictif de concurrence sur un marché.
A titre d’exemple, a déjà été considéré comme constitutif d’un abus de position dominante un discours ou une communication de l’entreprise en position dominante. [6]
Les abus peuvent consister en :
- Refus d’accès à une infrastructure essentielle, [4]
- Prix prédateurs ou excessifs, [5]
- Ventes liées,
- Conditions de transaction discriminatoires,
- Dénigrement. [6]
L’abus d’un état de dépendance économique (article 420-2 C. com.)
Spécificité du droit français, cette disposition protège une entreprise cliente ou fournisseur qui est dans l’impossibilité de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise. [7]
L’abus de dépendance économique suppose la réunion de trois conditions cumulatives : (1) l’existence d’une situation de dépendance économique d’une entreprise à l’égard d’une autre, (2) une exploitation abusive de cette situation et (3) une affectation (réelle ou potentielle) du fonctionnement ou de la structure de la concurrence. Dans sa jurisprudence la plus récente, la Cour de cassation définit en la matière la dépendance économique comme « l’impossibilité de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations que [le fournisseur] a nouées avec une autre entreprise » (Com., 10 nov. 2021, n° 20-13.385 ; dans le même sens, Com., 31 janv. 2024, n° 22-24.045).
L’Autorité de la concurrence peut enjoindre à l’entreprise en cause de modifier ou résilier les accords ayant permis de tels abus. [8]
Les pratiques restrictives de concurrence
La diversité des pratiques commerciales considérées comme restrictives de concurrence découle de l’accumulation dans le Code de commerce de procédés ou agissements que le législateur au fil des réformes a souhaité contrôler. L’article L. 442-1 du code de commerce a profondément remanié le régime des pratiques restrictives de concurrence. Il remplace l’ancienne énumération de treize pratiques prohibées (figurant auparavant à l’article L. 442-6) par une liste resserrée de trois pratiques, qui correspondent aux situations les plus fréquemment sources de litiges :
- L’obtention ou la tentative d’obtention d’un avantage sans contrepartie réelle, ou dont la contrepartie est manifestement disproportionnée par rapport au service effectivement fourni ;
- La soumission d’un partenaire commercial à des engagements entraînant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
- La rupture brutale d’une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit suffisant.
La sanction des pratiques prohibées par les articles L. 442-1, L. 442-2 et L. 442-3 du code de commerce est encadrée par l’article L. 442-4. La sanction prévue est une amende civile, si l’action est introduite par le ministre de l’Économie, dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants : cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus, – 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques.
II. Les mécanismes de contrôle et de sanction
La protection de l’entreprise passe aussi par la compréhension des risques encourus et des procédures de contrôle.
Le contrôle des concentrations
De manière préventive, les opérations de concentration (fusions, acquisitions de contrôle) doivent être notifiées à l’Autorité de la concurrence ou à la Commission européenne si certains seuils de chiffre d’affaires sont atteints [9], à savoir :
- le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d’euros ;
- le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d’euros ;
- l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
L’objectif est d’éviter la création ou le renforcement d’une position dominante.
La procédure de contrôle se déroule en premier temps avec une notification préalable obligatoire. Toute opération dépassant certains seuils de chiffre d’affaires doit être notifiée à la Commission européenne ou, selon la taille, aux autorités nationales de concurrence. Cette notification suspend l’opération jusqu’à autorisation. En deuxième temps, un examen en deux phases est mené
-
- Phase 1 (examen simplifié) : la Commission évalue en principe en un mois si l’opération soulève des doutes sérieux sur la concurrence. Si non, l’opération est autorisée.
- Phase 2 (examen approfondi) : si la phase 1 soulève des inquiétudes, une instruction approfondie est menée durant 4 mois (avec possible prolongation), avec audition des parties, collecte d’informations et analyses économiques, pouvant conduire à des engagements ou à une interdiction.
L’autorité de concurrence peut interdire la concentration, approuver librement ou après acceptation d’engagements visant à éliminer les risques anticoncurrentiels.
Si une entente anticoncurrentielle est suspectée dans le cadre d’une concentration, la Commission peut décider de cumuler le contrôle des concentrations avec une enquête antitrust classique. Elle peut enquêter sur l’entente suspectée qui risque de renforcer le pouvoir de marché à la suite de la concentration. La procédure de contrôle peut alors intégrer des mesures provisoires, des injonctions, et éventuellement une procédure sanctionnant l’entente d’une part, et décidant de la validité ou de la forme de la concentration d’autre part. Le contrôle des concentrations est ex ante (avant la réalisation de l’opération), tandis que les enquêtes sur les ententes sont souvent des procédures ex post mais peuvent aussi se cumuler au contrôle.
En outre, il existe une procédure dite de « simplifiée », prévue par les lignes directrices relatives au contrôle des concentrations de l’Autorité de la concurrence, qui permet aux entreprises de déposer un dossier simplifié et à l’Autorité de rendre une décision dans des délais raccourcis (environ 3 semaines au lieu de 5 semaines). Seules les opérations qui ne sont pas susceptibles, prima facie, de poser de problèmes de concurrence sont éligibles à la procédure simplifiée. Il s’agit des opérations pour lesquelles le ou les acquéreurs ne sont présents ni sur les mêmes marchés que la ou les cibles, ni sur des marchés amont, aval ou connexes, ou encore des opérations notifiables en application du II de l’article L. 430-2 du code de commerce relatif au commerce de détail (qui prévoit des seuils de notification spécifiques) et qui n’entraînent pas un changement d’enseigne.
Le non-respect de l’obligation de notification est sanctionné d’une amende pécuniaire dont le montant maximum s’élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu’a réalisé en France durant la même période la partie acquise et, pour les personnes physiques, à 1, 5 million d’euros. [10]
Les sanctions administratives et pénales
En droit de la concurrence, deux types de sanction coexistent :
- Les sanctions administratives : l’Autorité de la concurrence et la Commission européenne peuvent infliger de lourdes sanctions pécuniaires, proportionnées à la gravité des faits, au dommage causé à l’économie et à la situation de l’entreprise. Elles peuvent également prononcer des injonctions. En France, pour des pratiques anticoncurrentielles, le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre [11]. En outre, les autorités peuvent enjoindre aux entreprises de procéder à la publication, la diffusion ou l’affichage de ses décisions ou d’un extrait selon des modalités qu’elle précise, par exemple dans des journaux ou sur Internet. Cette injonction a pour but d’informer le public sur les pratiques sanctionnées pour prévenir toute récidive et favoriser la transparence du contrôle de la concurrence.
- Les sanctions pénales : le fait pour une personne physique de prendre une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles est un délit pénal, puni d’un emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 75.000 euros [12].
Les actions en réparation ou Private Enforcement
Toute personne ayant subi un préjudice du fait d’une pratique anticoncurrentielle peut en demander réparation. Une décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission constatant une infraction établit une présomption irréfragable de faute, ce qui facilite grandement l’action de la victime puisqu’elle n’aura qu’à démontrer son préjudice [13].
Pour une entreprise, cela représente à la fois un risque (être poursuivie par ses clients/concurrents) et une opportunité (agir en réparation si elle est victime).
III. Stratégies de protection et de prévention
Une entreprise peut adopter plusieurs stratégies proactives pour se protéger (1.), mais peut également réagir pour amoindrir la sanction potentielle (2.).
Prévenir les pratiques anticoncurrentielles
Le programme de conformité (Compliance)
La mesure de protection la plus efficace est préventive. Un programme de conformité au droit de la concurrence vise à prévenir, détecter et traiter les risques d’infraction. Il doit inclure :
- Un engagement clair de la direction.
- Une cartographie des risques (identification des activités et personnels les plus exposés).
- La rédaction de guides et de procédures internes claires.
- La formation régulière des salariés, en particulier les équipes commerciales et les dirigeants.
- La mise en place d’un mécanisme d’alerte interne.
La vigilance contractuelle
Il est impératif de faire auditer régulièrement les contrats commerciaux (distribution, franchise, conditions générales de vente, etc.) pour s’assurer qu’ils ne contiennent pas de clauses anticoncurrentielles (exemple : clauses de prix de revente imposé, restrictions de clientèle ou de territoire excessives), mais également les comportements avec les partenaires. De même, les clauses de non-concurrence doivent être justifiées et proportionnées pour être valides [16].
Vers une modération des sanctions
La clémence
Une entreprise ayant participé à une entente anticoncurrentielle a la possibilité de révéler l’existence de celle-ci aux autorités de concurrence. En fonction de son rang de dénonciation et de sa coopération, elle peut obtenir une immunité totale ou une réduction partielle de l’amende qu’elle aurait autrement encourue. C’est un outil de défense essentiel lorsqu’une infraction est avérée.
Pour bénéficier de cette exonération, il faut que l’entreprise contribue de façon positive au traitement du cas, en particulier en apportant des preuves de l’infraction, et qu’elle coopère de façon véritable, totale, permanente et rapide au traitement de l’affaire.
A titre d’exemple, quatre fabricants de lessive actifs en France ont été sanctionnés à hauteur de 367,9 millions d’euros en 2011 par l’Autorité. Le cartel avait duré de 1997 à 2004, et fut sanctionné en 2011, suite à la demande de clémence d’un des participants au cartel. Cette entreprise, qui a dévoilé l’affaire en 2008 à l’Autorité, à l’occasion d’une enquête dans un autre secteur, a pu échapper à une sanction de 248,5 millions d’euros. [15]
La procédure de transaction
En France, l’Autorité de la concurrence peut proposer une transaction aux entreprises qui ne contestent pas les griefs notifiés. En échange, une réduction du montant de la sanction est accordée.
Cette procédure s’est imposée comme un outil apprécié par les entreprises : depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi Macron, 12 décisions ont été rendues au bénéfice d’une transaction, représentant près de 672,5 millions d’euros de sanction. Les décisions de transaction ont concerné les pratiques les plus variées, que ce soit des abus de position dominante ou des cartels de grande envergure ou encore de gun jumping. [16]
En conclusion, la protection d’une entreprise en droit de la concurrence repose sur une double approche : une prévention rigoureuse via des programmes de conformité et une vigilance juridique constante, et une gestion réactive et stratégique des risques avérés, en utilisant les procédures de clémence ou de transaction et en se préparant à d’éventuels contentieux indemnitaires.
Sources
- Com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610
- Autorité de la concurrence, Décision 24-D-02 du 6 février 2024
- CJUE, 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, point 91
- Autorité de la concurrence, Décision 15-D-10 du 11 juin 2015
- CJCE, 3 juillet 1991, C-62/86
- , 25 juin 2025, n° 23-13.391
- Cour d’appel de Paris, 6 octobre 2022, n° 20/08582 ; Com., 12 février 2013, n° 12-13.603
- Article L.430-9 du code de commerce
- Articles L.430-2 et suivants du code de commerce
- Article L.430-10 du code de commerce
- Article L.464-2 du code de commerce
- Article L.420-6 du code de commerce
- Article L.481-2 du code de commerce
- Article L.341-2 du code de commerce ; Cour d’appel de Paris, 8 février 2023, n°20/14328
- Autorité de la concurrence, Décision 11-D-17 du 8 décembre 2011
- À titre d’exemples : Décision 17-D-20 du 18 octobre 2017 ; Décision 18-D-24 du 5 décembre 2018
Le cabinet vous accompagne dans toutes vos démarches juridiques et reste à votre disposition pour répondre à vos questions. N’hésitez pas à nous contacter pour bénéficier d’un conseil personnalisé et adapté à votre situation.
Découvrez nos services et outils associés

Réseaux de distribution, Concurrence
Programmes de conformité concurrentielle
Le droit de pratiques anticoncurrentielles constitue un enjeu majeur pour les entreprises.
Le contrôle de la concurrence et les prérogatives des autorités communautaires de l’Autorité de la concurrence se sont accrus.
Le montant des sanctions s’est accru, et le risque est majeur, des solutions alternatives aux procédures contentieuses (clémence, transaction, engagements) s’étant toutefois développées en permettant d’offrir des outils de gestion de risque additionnels.
Le droit de pratiques anticoncurrentielles constitue un enjeu majeur pour les entreprises.
Le contrôle de la concurrence et les prérogatives des autorités communautaires de l’Autorité de la concurrence se sont accrus.
Le montant des sanctions s’est accru, et le risque est majeur, des solutions alternatives aux procédures contentieuses (clémence, transaction, engagements) s’étant toutefois développées en permettant d’offrir des outils de gestion de risque additionnels.

Réseaux de distribution, Concurrence
Contrôle et contentieux de la concurrence
Vous devez faire face à un litige devant la DGCCRF, l'autorité de la Concurrence ou la Commission Européenne pour une problématique relative au droit de la concurrence ?
Gouache Avocats assiste ses clients depuis l'opération de visite et de saisie jusqu'à une éventuel contentieux devant les juridictions françaises ou communautaires.
Vous devez faire face à un litige devant la DGCCRF, l'autorité de la Concurrence ou la Commission Européenne pour une problématique relative au droit de la concurrence ?
Gouache Avocats assiste ses clients depuis l'opération de visite et de saisie jusqu'à une éventuel contentieux devant les juridictions françaises ou communautaires.

Réseaux de distribution, Concurrence
Ententes
Le Cabinet Gouache Avocats vous conseille sur la licéité de vos accords et pratiques au regard de la réglementation française et communautaire de la concurrence et dans la mise en place de programme de conformité (« compliance programs ») au sein de votre entreprise.
Le Cabinet Gouache Avocats accompagne également les entreprises dans le cadre de procédures engagées par l’Autorité de la concurrence ou la Commission européenne (demande de renseignements, visites et saisies, procédures de clémence, transaction, engagements), de contentieux devant les juridictions nationales et communautaires et assiste les entreprises souhaitant se plaindre d’éventuelles ententes anticoncurrentielles dans leur secteur d’activité.
Gouache avocats vous accompagne pour évaluer votre risque et vous défendre.
Le Cabinet Gouache Avocats vous conseille sur la licéité de vos accords et pratiques au regard de la réglementation française et communautaire de la concurrence et dans la mise en place de programme de conformité (« compliance programs ») au sein de votre entreprise.
Le Cabinet Gouache Avocats accompagne également les entreprises dans le cadre de procédures engagées par l’Autorité de la concurrence ou la Commission européenne (demande de renseignements, visites et saisies, procédures de clémence, transaction, engagements), de contentieux devant les juridictions nationales et communautaires et assiste les entreprises souhaitant se plaindre d’éventuelles ententes anticoncurrentielles dans leur secteur d’activité.
Gouache avocats vous accompagne pour évaluer votre risque et vous défendre.

Et les ressources sur le même thème : "Programmes de conformité concurrentielle"
Réseaux de distribution, Concurrence
La Cour de cassation précise les critères du dénigrement constitutif d’un abus de position dominante
Dans l’Affaire Lucentis/Avastin, La Chambre commerciale vient de rendre un arrêt intéressant qui redéfinit les contours du dénigrement constitutif d’un abus de position dominante.
Réseaux de distribution, Concurrence
Analyse des sanctions récentes en droit de la concurrence
Les sanctions en droit de la concurrence en France et dans l’Union européenne ont été particulièrement marquantes en 2024 et 2025, avec des montants record et des cas emblématiques concernant des pratiques anticoncurrentielles, des ententes et des abus de position dominante.
Réseaux de distribution, Concurrence
Cautionnement disproportionné: à qui la charge de la preuve?
La Cour de cassation précise à qui incombe la charge de la preuve lorsqu’il est invoqué un cautionnement disproportionné. Il est fréquent dans les réseaux de distribution que les enseignes sollicitent des engagements de cautions à leur profit. Ces engagements peuvent être pris par le dirige…