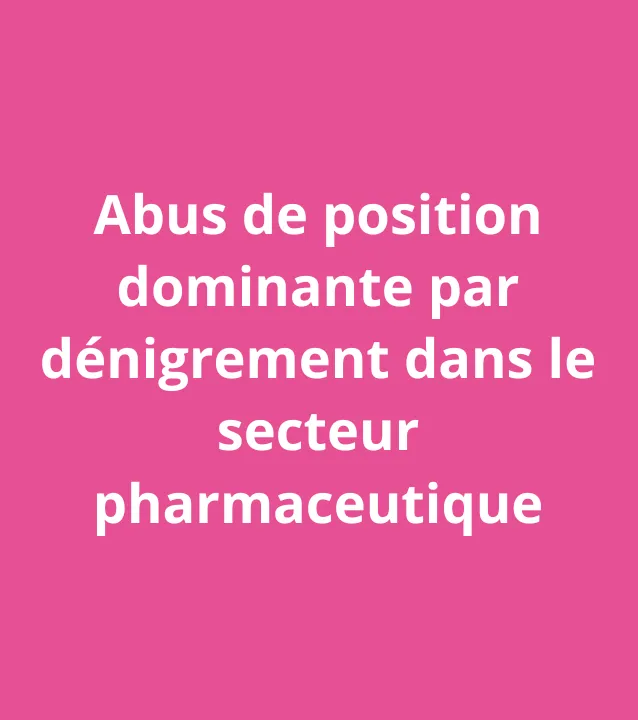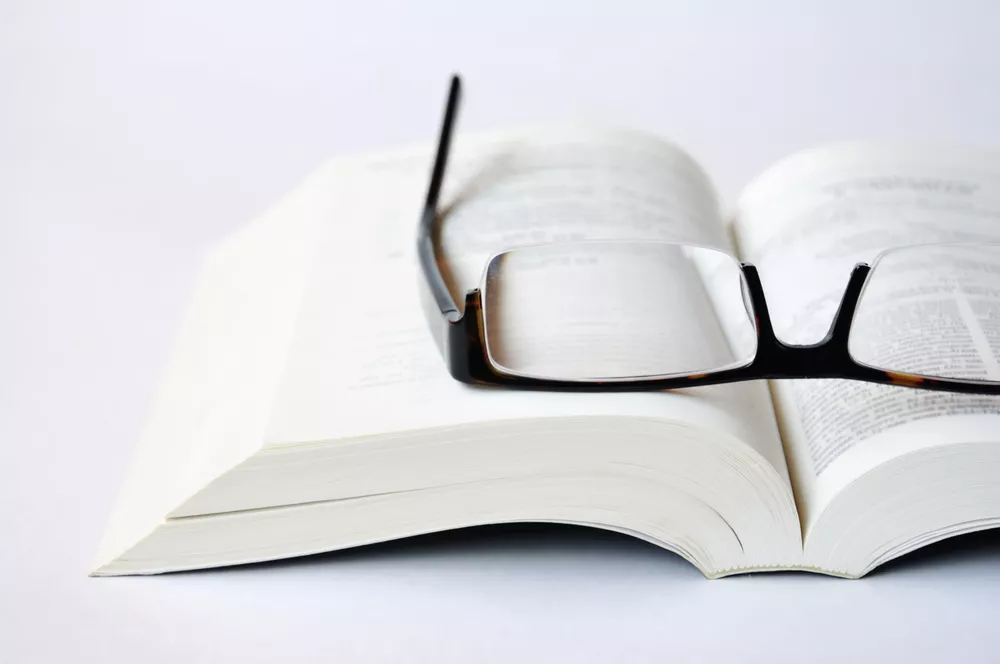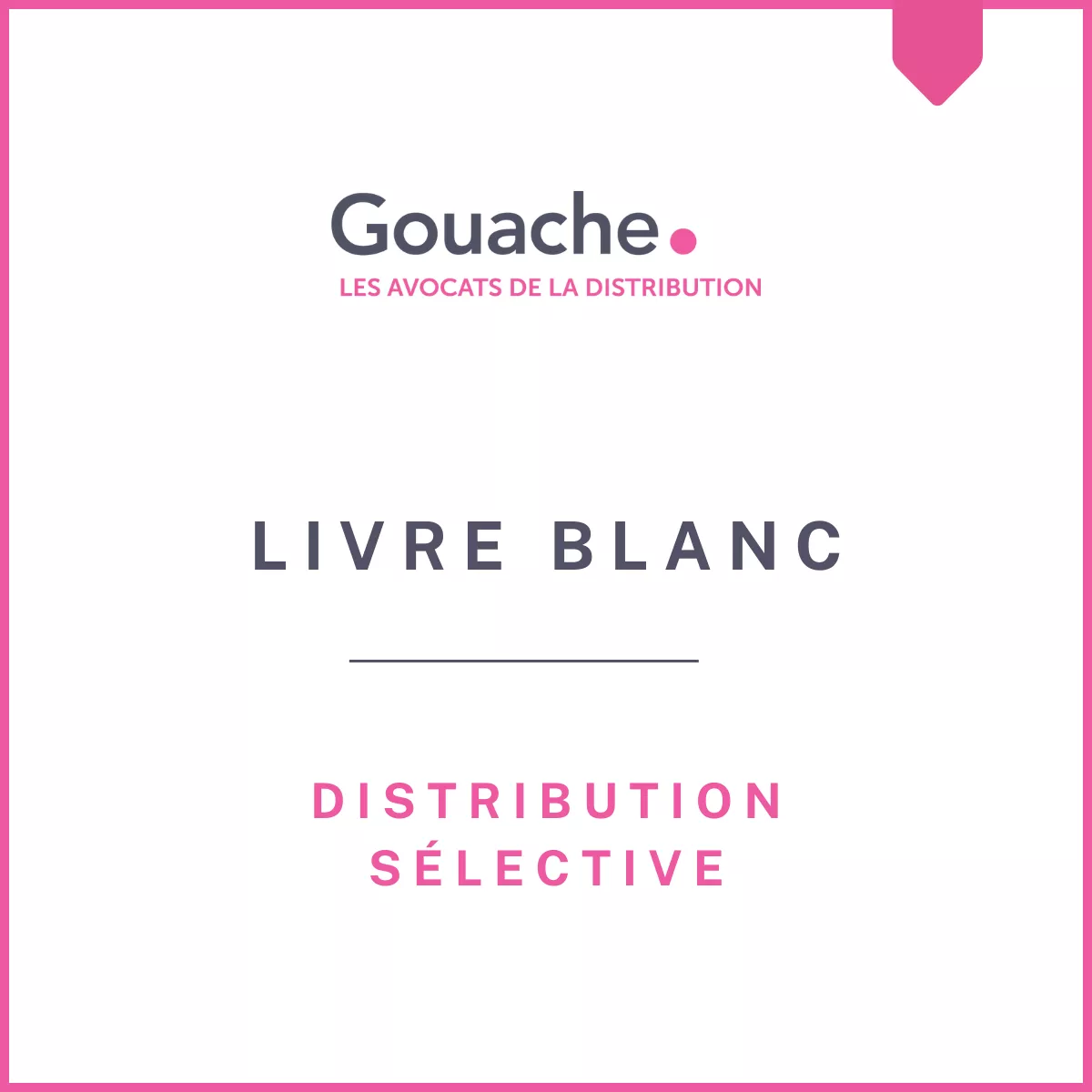Validation de la loi « Sapin II » par le Conseil constitutionnel : les modifications apportées
La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II , adoptée par le Parlement le 8 novembre dernier et validée par le Conseil constitutionnel le 8 décembre dernier apporte de nombreuses modifications dans les relations entre commerçants.
Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique adopté le 8 novembre 2016 et Décision du Conseil constitutionnel n°2016-741 DC du 8 décembre 2016
Commentaire :
Le 8 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a validé les dispositions de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, qui avait été définitivement adoptée par le Parlement le 8 novembre dernier.
Cette loi apporte de nombreuses modifications en matière de délais de paiement, dans les relations entre fournisseurs et distributeurs et en matière de pratiques restrictives de concurrence.
1. Délais de paiement
• La loi Sapin 2 renforce la sanction encourue par les personnes morales en cas de non-respect des délais de paiement et prévoit une publication systématique des décisions de sanction
Le montant de l’amende administrative encourue par les personnes morales en cas de non-respect des délais de paiement passe de 375.000 euros à 2 millions d’euros. Cette modification s’applique à la fois en cas de non-respect des délais de paiement prévus à l’article L. 441-6 du Code de commerce et de ceux prévus à l’article L. 441-3 du Code de commerce (L. 441-6 et L.443-1 C.com).
Le texte prévoit également que la décision de sanction prise par l’administration sera systématiquement publiée (L.465-2 C.com).
• La loi Sapin 2 introduit un délai de paiement dérogatoire pour les biens destinés à faire l’objet d’une livraison hors Union européenne
La loi Sapin 2 introduit un délai de paiement dérogatoire aux délais prévus par les articles L. 441-6 et L. 443-1 du Code de commerce, à savoir un délai maximal de 90 jours à compter de la date d’émission de la facture pour les achats effectués en franchise de la TVA en application de l’article 275 du Code général des impôts « de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne », sauf pour les achats effectués par les grandes entreprises (L. 441-6 et L. 443-1 C. com).
Le délai convenu par les parties devra être stipulé par contrat et ne devra pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier.
Le texte prévoit également que si les biens ne font finalement pas l’objet d’une livraison hors de l’Union européenne, l’acheteur se verra appliquer des pénalités de retard.
2. Relations fournisseurs/distributeurs
• La loi Sapin 2 assouplit le régime de la convention unique
Le texte prévoit que la convention unique pourra être conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. Avant la présente réforme, les entreprises avaient l’obligation de conclure une convention unique chaque année, ce qui était particulièrement contraignant pour les entreprises. Cet assouplissement vient donc soulager ces dernières.
Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou trois ans, le texte précise qu’elle devra fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu sera révisé. Les entreprises pourront prendre en compte un ou plusieurs indices publics reflétant l’évolution des prix des facteurs de production (L. 441-7 C.com).
Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre fournisseurs et grossistes prévues par l’article L. 441-7-1 du Code de commerce.
Le texte sera applicable aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017.
• La loi Sapin 2 introduit des dispositions spécifiques concernant l’achat ou la vente de certains produits
Pour les produits agricoles mentionnées à l’article L. 441-2-1 du Code de commerce (principalement les fruits et légumes destinés à être vendus à l’état frais, les viandes fraîches et congelées de volaille et de lapin, le miel et les œufs), le lait et les produits laitiers, les avantages promotionnels (NIP) ne pourront dépasser 30% de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris. Cette réforme est destinée à limiter les baisses de prix consécutives à ces pratiques promotionnelles (L. 441-7 C.com).
Le texte ajoute une disposition spécifique pour les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l’objet d’un contrat écrit (en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime). Le contrat écrit devra d’indiquer « le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles ». Les parties pourront faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires pour définie ce prix. La loi précise que ces indices pourront être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel et qu’ils devront être fixés de bonne foi entre les parties (L. 441-6, I, 6ème alinéa C.com).
Enfin, la loi prévoit l’obligation de mentionner, dans les contrats d’une durée inférieure à un an conclus entre un fournisseur de produits alimentaires sous MDD et un distributeur, portant sur la conception et la production de produits alimentaires, « le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires » (lorsque ces produits agricoles doivent faire l’objet d’un contrat écrit en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime). Pour la détermination des prix, le fournisseur et le distributeur pourront faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices devront être fixés de bonne foi entre les parties et pourront être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel (L. 441-10 C.com).
3. Pratiques restrictives de concurrence
• La loi Sapin 2 élargit le champ des pratiques restrictives de concurrence
Le texte introduit une nouvelle pratique restrictive de concurrence interdite : le fait « de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités de retard de livraison en cas de force majeure » (L. 442-6, I, 13° C.com).
Le texte vient également préciser que peut constituer un avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu :
– la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, à une opération de « promotion » commerciale (le texte ne visait avant que l’opération « d’animation » commerciale) ;
– « la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs » (L. 442-6, I, 1° C.com).
Enfin, la loi introduit un article L. 442-6, I, 7° dans le Code de commerce prévoyant l’interdiction pour un partenaire commercial d’imposer une clause de révision de prix ou de renégociation de prix qui ferait référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l’objet du contrat.
• La loi Sapin 2 renforce la sanction des pratiques restrictives de concurrence
Le montant de l’amende civile encourue par les personnes morales en cas de pratiques restrictives de concurrence pouvant être prononcé par le Ministre chargé de l’économie ou le Ministère public passe de 2 à 5 millions d’euros (L. 442-6, III, C.com).
Comme en matière de délais de paiement, le texte prévoit également que les décisions de sanction seront systématiquement publiées (L. 442-6, III, C.com).
Découvrez nos services et outils associés

Produits, Consommation, Publicité
Concurrence déloyale et parasitaire
Si tout professionnel peut porter préjudice à son concurrent, c’est à condition de ne pas utiliser de procédés déloyaux, c’est-à-dire, contraires aux usages professionnels, afin de détourner la clientèle de son concurrent. La faute dans l’exercice de la concurrence oblige son auteur à verser des dommages et intérêts si un préjudice a été subi.
Si tout professionnel peut porter préjudice à son concurrent, c’est à condition de ne pas utiliser de procédés déloyaux, c’est-à-dire, contraires aux usages professionnels, afin de détourner la clientèle de son concurrent. La faute dans l’exercice de la concurrence oblige son auteur à verser des dommages et intérêts si un préjudice a été subi.
Et les ressources sur le même thème : "Pratiques restrictives de concurrence"
Réseaux de distribution, Concurrence
La Cour de cassation précise les critères du dénigrement constitutif d’un abus de position dominante
Dans l’Affaire Lucentis/Avastin, La Chambre commerciale vient de rendre un arrêt intéressant qui redéfinit les contours du dénigrement constitutif d’un abus de position dominante.
Réseaux de distribution, Concurrence
L’articulation entre « avantage sans contrepartie » et « déséquilibre significatif »
« Avantage sans contrepartie » et « déséquilibre significatif » : des fondements qui se cumulent, se recoupent mais dont le régime diffère. A l’heure où l’on parle d’avancer les négociations commerciales, il est intéressant de s’arrêter sur la décision rendue par la Cour d’appel de Paris du…
Réseaux de distribution, Concurrence
Réponse du Ministre de l’Economie sur l’encadrement des ventes “one shot”
Le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance dans une réponse à une question parlementaire a apporté des précisions sur les ventes « one-shot » (ventes en un coup) dont peuvent être victimes certains professionnels auxquels des fournisseurs de biens et services ont fait sig…
Réseaux de distribution, Concurrence
Distribution sélective
La distribution sélective s’analyse comme une technique de commercialisation choisie par un promoteur de réseau et selon laquelle ses produits sont diffusés uniquement par des distributeurs sélectionnés spécifiquement à cet effet. Un promoteur de réseau peut choisir de mettre en place un rés…