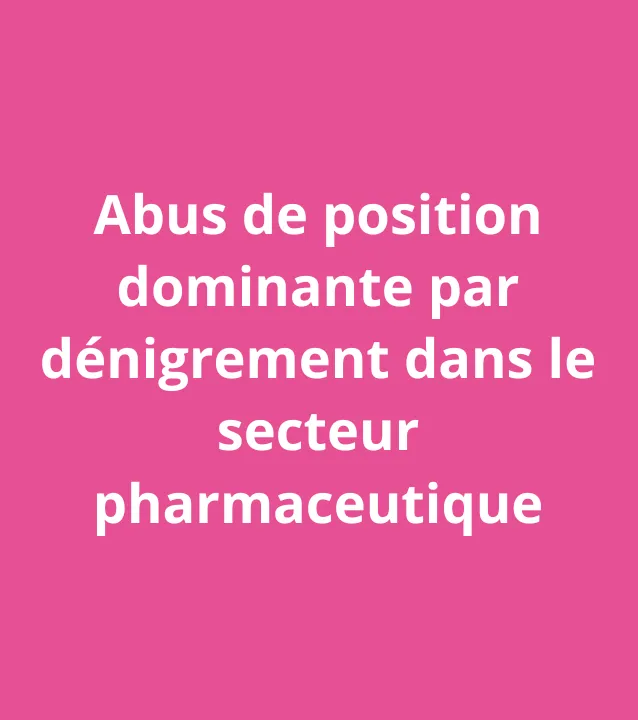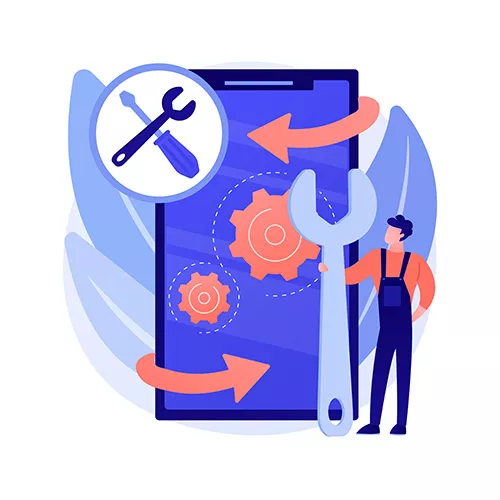
Le calcul de la créance de réparation des victimes des pratiques anticoncurrentielles
La méthode d’évaluation du préjudice concurrentiel précisée par la Cour de cassation.
Suivant la décision de l’Autorité ayant condamné les sociétés LACTALIS pour entente sur les produits laitiers (11 mars 2015, 15-D-03), les sociétés Cora et Supermarchés Match ont saisi le juge civil pour obtenir réparation de leur préjudice du fait de la pratique anticoncurrentielle, laquelle constitue une faute civile.
Après avoir été déboutées par le Tribunal de commerce de Paris, la Cour d’appel, infirmant le jugement, a fait droit à leur demande de réparation.
Devant la Cour de cassation, le débat a essentiellement porté sur l’imputabilité de la sanction civile d’une part, et l’évaluation du préjudice d’autre part.
La responsabilité de la société mère du fait des agissements anticoncurrentiels de sa filiale
Aux termes de son premier moyen, le Groupe Lactalis contestait que lui soit opposée la présomption irréfragable de faute posée par la Directive dommage, alors qu’elle n’était pas auteur des faits et que les pratiques illicites étaient antérieures à ladite Directive transposée en 2017. Ainsi, elle soutenait que sa responsabilité devait être examinée au regard du droit commun de la responsabilité civile.
Si cet argument surprend à la première lecture – la Cour d’appel ne s’étant pas fondée sur la Directive dommage, on peut y voir une tentative de la société mère à inviter le juge sur le terrain de la responsabilité civile, plutôt qu’à chercher à combattre la présomption – théoriquement réfragable – de la responsabilité de la société mère du fait des agissements anticoncurrentiels de sa filiale ; en effet, à ce jour, on ne connait aucune décision dans laquelle, cette présomption a pu être combattue.
Pratiques anticoncurrentielles : L’évaluation du préjudice et le taux marginal de financement
S’agissant du calcul de l’indemnisation, la Cour d’appel a pris pour assiette les sommes dont les sociétés Cora et Supermarchés Match ont été privées, et a appliqué un taux d’intérêt égal au taux marginal de financement. La Cour de cassation a été sollicitée pour se positionner sur la licéité de ce calcul.
Se référant au principe de réparation intégrale, « tout le préjudice et rien que le préjudice », la Cour de cassation rappelle que faute « d’établir la nature de l’usage qu’auraient fait les sociétés Cora et Match des sommes perdues et permettant l’octroi d’un taux d’intérêt supérieur au taux légal, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». En d’autres termes, le taux marginal de financement peut servir de référence pour le calcul de la réparation, mais il faut pouvoir justifier de la nature et de l’usage qui en aurait été fait.
Pratiques anticoncurrentielles : Les intérêts compensatoires
Une fois la créance de réparation calculée, des intérêts compensatoires peuvent s’y appliquer pour compenser le préjudice résultant de la privation des sommes. En l’occurrence, la Cour de cassation fixe le point de départ du calcul des intérêts compensatoires à la date de la fin des agissements anticoncurrentiels – et non à la date à laquelle la créance est reconnue judiciairement.
Dans la mesure où ce préjudice se constitue progressivement, la Cour de cassation indique que les intérêts compensatoires « doivent être alloués en tenant compte de la progressivité de la constitution de ce préjudice ». Elle laisse à la cour de renvoi le soin de procéder au calcul, laquelle retiendra probablement un calcul par capitalisation annuelle.
Pratiques anticoncurrentielles : La solidarité des coauteurs et la contribution à la dette
S’agissant de l’imputabilité de la sanction aux coauteurs, deux sujets sont dans le débat : celui de la solidarité des coauteurs et celui de la contribution à la dette.
Aux termes d’un pourvoi incident, les victimes de l’entente discutaient la décision rendue par la Cour d’appel en ce qu’elle avait condamné chacune des sociétés auteurs de l’entente à indemniser les victimes pour des montants déterminés et distincts.
Pour leur part, les sociétés LACTALIS discutent la décision en ce qu’elle a – sous couvert de prononcer des condamnations in solidum, – fixé la réparation du préjudice entre cartellistes, selon la gravité de leur implication appréciée au regard des niveaux d’amendes.
Or, cette répartition contrevient au principe de la responsabilité solidaire des coauteurs d’un même dommage pour la réparation de l’entier préjudice.
Elle méconnait également les dispositions de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce, alors applicable au litige, qui prescrit que les sanctions ne se fondent pas sur la seule gravité du comportement des auteurs de pratiques anticoncurrentielles.
Aussi, sur le pourvoi incident, bien que la demande soit devenue sans objet puisque la décision avait été exécutée, la Cour de cassation prend soin de rappeler que la Cour d’appel aurait dû « condamner l’ensemble des coauteurs d’un même dommage in solidum ».
Quant à la contribution à la dette, la Cour de cassation écarte l’application du droit commun au bénéfice de l’article L462-8 du code de commerce, texte spécial applicable aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles.
Cet arrêt offre une méthodologie pour l’évaluation du préjudice qu’il sera recommandé de suivre à l’avenir.
Découvrez nos services et outils associés

Immobilier commercial
Cession d'un fonds de commerce
Vous souhaitez céder votre fonds de commerce.
Vous pouvez réaliser cette opération déterminante avec une certaine célérité, une exacte visibilité de vos coûts, et en toute sécurité.
Il s’agit d’identifier et de négocier les paramètres de la cession de votre fonds de commerce.
Vous souhaitez céder votre fonds de commerce.
Vous pouvez réaliser cette opération déterminante avec une certaine célérité, une exacte visibilité de vos coûts, et en toute sécurité.
Il s’agit d’identifier et de négocier les paramètres de la cession de votre fonds de commerce.
Et les ressources sur le même thème : "Pratiques anticoncurrentielles"
Réseaux de distribution, Concurrence
La Cour de cassation précise les critères du dénigrement constitutif d’un abus de position dominante
Dans l’Affaire Lucentis/Avastin, La Chambre commerciale vient de rendre un arrêt intéressant qui redéfinit les contours du dénigrement constitutif d’un abus de position dominante.
Réseaux de distribution, Concurrence
Entente horizontale sur le BPA dans les contenants alimentaires
Dans une décision n° 23-D-15 du 29 décembre 2023, l’Autorité de la concurrence a sanctionné plusieurs organismes professionnels et entreprises pour avoir mis en œuvre une stratégie collective visant à empêcher les industriels du secteur de se faire concurrence sur la question de la pré…
Réseaux de distribution, Concurrence
Analyse des sanctions récentes en droit de la concurrence
Les sanctions en droit de la concurrence en France et dans l’Union européenne ont été particulièrement marquantes en 2024 et 2025, avec des montants record et des cas emblématiques concernant des pratiques anticoncurrentielles, des ententes et des abus de position dominante.
Réseaux de distribution, Concurrence
Droit de la concurrence : comment protéger son entreprise ?
Pour protéger une entreprise en droit de la concurrence, il est essentiel de comprendre les pratiques prohibées et les mécanismes de défense et de prévention.