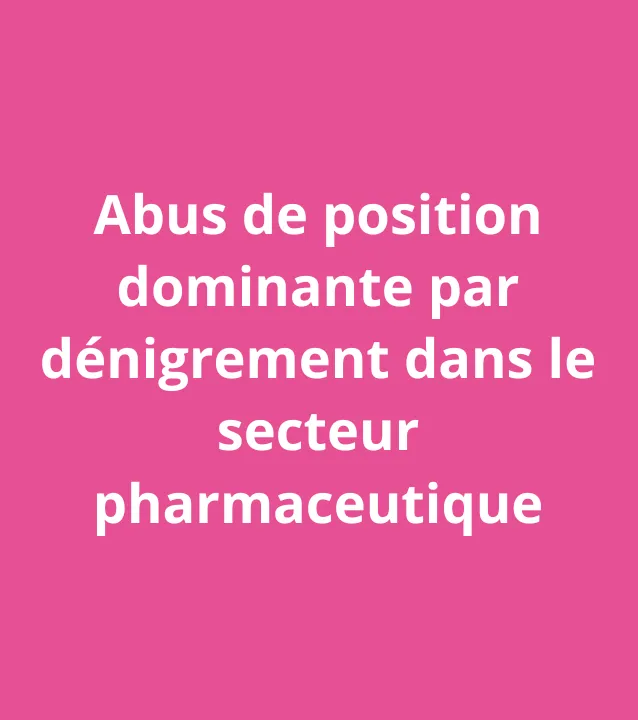Rappel sur la Loi Lurel
Une récente décision de l’autorité de la concurrence est l’occasion de rappeler l’interdiction d’octroyer des exclusivités d’importation dans les départements et collectivités d’outre-mer.
La loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer (dite loi « Lurel ») avait introduit dans le code de commerce l’article L. 420-2-1, rédigé comme suit :
« Sont prohibés, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises. »
Cet article figure dans la section du Code de commerce consacrée aux pratiques anti-concurrentielles, c’est-à-dire les ententes et abus de position dominante.
En l’occurrence, les pratiques examinées concernaient des accords de distribution conclus dans le secteur de la parfumerie et des cosmétiques. Plusieurs accords prévoyant une telle exclusivité ont été examinés. Il s’agissait soit d’accords antérieurs à la loi, mais qui s’étaient prolongés au-delà du 22 mars 2013, qui était la date limite de mise en conformité à la nouvelle loi, soit d’accords conclus postérieurement.
L’Autorité de la concurrence a déjà rendu plusieurs décisions en lien avec l’application de cette disposition (décision n°16-D15 du 6 juillet 2016, décision n°17-D-14 du 27 juillet 2017, décision n°18-D-03 du 20 février 2018, décision n°18-D-21 du 8 octobre 2018, décision n°19-D-11 du 29 mai 2019). Cette décision permet de rappeler quelques principes quant à l’application de cette loi :
– L’Autorité sanctionne à la fois les fournisseurs et les distributeurs. Les premiers pour avoir octroyé des droits exclusifs d’importation, les seconds pour en avoir bénéficié ;
– Sont sanctionnées non seulement les sociétés directement parties aux accords mais également leurs sociétés mères. En effet, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère lorsqu’elle détient, directement ou indirectement, la totalité, ou la quasi-totalité du capital de la filiale. Dans ce cas, il est en effet présumé, à moins que la preuve contraire ne soit apportée, que la société mère a eu une influence déterminante sur la politique commerciale de sa filiale ;
– Lorsque la personne morale auteur de l’infraction n’existe plus, la pratique sera imputée à la personne morale à qui l’entreprise a été transmise, c’est-à-dire celle à qui l’entreprise a été juridiquement transmise ou, à défaut, « celle qui en assure, en fait, la continuité économique et fonctionnelle ». Dans ce cas, peuvent être retenues tant les responsabilités de l’ancienne société mère, que du repreneur.
Concernant les sanctions, en application de l’article L.464-2 du Code de commerce, les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation individuelle de chaque entreprise sanctionnée et à l’éventuelle réitération des pratiques. Quand bien même il a pu être considéré par une précédente décision de l’autorité de la concurrence (Décision n°16-D-15 du 6 juillet 2016) « qu’elles ne revêtaient pas le même degré de gravité que les infractions au droit commun de la concurrence, ententes et abus de position dominante », cette décision rappelle que les pratiques contraires à la loi Lurel ayant lieu « sur des territoires où la concurrence est déjà très atténuée, peuvent être considérées comme graves ». Elle considère en outre qu’une telle pratique restreint la concurrence intra-marque entre distributeurs, mais également qu’elle « peut donner aux fabricants concurrents le signal qu’il n’adoptera pas de politique tarifaire agressive, atténuant ainsi la concurrence inter-marques sur les prix ». L’autorité de la concurrence considère donc que le dommage causé à l’économie est significatif.
La décision intervenait en l’occurrence dans le cadre d’une procédure de transaction. Les sanctions ont ainsi été définies à l’intérieur de la fourchette fixée par le procès-verbal de transactions. En outre dans cette hypothèse, les sanctions sont, en application de l’article L. 464-5 du code de commerce, limitées à un plafond de 750.000 euros pour chacun des auteurs. En l’espèce, les sanctions prononcées se sont étalées, selon les sociétés concernées, de 11.520 euros à 68.000 euros. Pour rappel, en l’absence de transaction, le « montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. » (Ccom. Art. L 464-2), et ceci outre d’éventuels dommages et intérêts réclamés par les victimes de la pratique anticoncurrentielle (y compris le cas échéant les concurrents).
Il convient donc de rester vigilant quant à l’application de ce texte et prendre soin de s’assurer que les accords conclus pour la distribution de produits outre-mer ne prévoient pas d’exclusivité.
Autorité de la concurrence, décision 19-D-20 du 8 octobre 2019
Découvrez nos services et outils associés

Réseaux de distribution, Concurrence
Assigner ou se défendre contre un distributeur
Un litige vous oppose à un ou plusieurs de vos distributeurs ?
En matière économique, du fait de l’importance du facteur temps, il est souvent primordial de trouver rapidement un arrangement acceptable.
Avocats de réseaux de distribution, notre approche du contentieux réside en premier lieu dans la prévention et l’anticipation de ceux-ci.
Quand survient un contentieux, notre connaissance des réseaux de distribution et du droit de la distribution nous permet d’être très pro actifs à vos côtés pour la recherche et la production des preuves pertinentes.
Un litige vous oppose à un ou plusieurs de vos distributeurs ?
En matière économique, du fait de l’importance du facteur temps, il est souvent primordial de trouver rapidement un arrangement acceptable.
Avocats de réseaux de distribution, notre approche du contentieux réside en premier lieu dans la prévention et l’anticipation de ceux-ci.
Quand survient un contentieux, notre connaissance des réseaux de distribution et du droit de la distribution nous permet d’être très pro actifs à vos côtés pour la recherche et la production des preuves pertinentes.
Et les ressources sur le même thème : "Pratiques anticoncurrentielles"
Réseaux de distribution, Concurrence
La Cour de cassation précise les critères du dénigrement constitutif d’un abus de position dominante
Dans l’Affaire Lucentis/Avastin, La Chambre commerciale vient de rendre un arrêt intéressant qui redéfinit les contours du dénigrement constitutif d’un abus de position dominante.
Réseaux de distribution, Concurrence
Entente horizontale sur le BPA dans les contenants alimentaires
Dans une décision n° 23-D-15 du 29 décembre 2023, l’Autorité de la concurrence a sanctionné plusieurs organismes professionnels et entreprises pour avoir mis en œuvre une stratégie collective visant à empêcher les industriels du secteur de se faire concurrence sur la question de la pré…
Réseaux de distribution, Concurrence
Analyse des sanctions récentes en droit de la concurrence
Les sanctions en droit de la concurrence en France et dans l’Union européenne ont été particulièrement marquantes en 2024 et 2025, avec des montants record et des cas emblématiques concernant des pratiques anticoncurrentielles, des ententes et des abus de position dominante.
Réseaux de distribution, Concurrence
Droit de la concurrence : comment protéger son entreprise ?
Pour protéger une entreprise en droit de la concurrence, il est essentiel de comprendre les pratiques prohibées et les mécanismes de défense et de prévention.